
Comment Grasse est devenue la capitale du parfum ?
Du 3 au 5 juillet, la Grasse Perfume Week animera les collines ensoleillées du Sud de la France. Si vous aimez le parfum, vous en avez forcément entendu parler. Mais savez-vous pourquoi Grasse est appelée la “capitale mondiale du parfum” ?
Ce titre ne vient pas d’un slogan, encore moins d’une opération marketing. Il s’est construit au fil des siècles, entre climat privilégié, culture florale minutieuse et gestes artisanaux devenus références. Car derrière chaque fragrance, il y a une origine, une histoire, un lieu. Et très souvent, ce lieu, c’est Grasse.
Dans cet article, nous vous proposons de (re)découvrir ce territoire à part : des champs de jasmin à l’innovation durable, des gantiers-parfumeurs du XVIᵉ siècle aux laboratoires d’aujourd’hui.
Un terroir propice au développement de la parfumerie
On ne devient capitale du parfum par accident. Grasse l’est devenue parce que tout, ici, semblait l’y conduire.
Il faut d’abord regarder la terre, le ciel, et ceux qui la cultivent depuis des générations. C’est là que tout commence. Avec ses hivers cléments, ses étés lumineux et secs, et son humidité parfaitement dosée, Grasse offre aux fleurs bien plus qu’un climat agréable : un vrai terrain d’expression.
La ville profite d’un microclimat unique favorisé par l’effet de foehn. Ce phénomène météorologique, dû à la proximité des montagnes, apporte un air plus sec et plus chaud en redescendant vers la ville. Résultat : un climat idéal pour la culture florale (rose de mai, jasmin…), limitant les maladies et améliorant la qualité des récoltes. C’est l’un des secrets naturels qui ont fait la renommée de Grasse dans le monde du parfum.
Ajoutez à cela la lumière presque constante, et les pentes douces qui multiplient les expositions, et l’altitude idéale , et de nombreuses sources naturelles: tout concourt à donner aux fleurs une intensité rare.
Quatre fleurs emblématiques dessinent depuis longtemps le profil olfactif de la région : le jasmin Grandiflorum, la rose Centifolia, la tubéreuse et la lavande vraie. Mais chacune d’elles impose son propre rythme, ses exigences, et sa manière d’être approchée.




Le jasmin, par exemple, ne se cueille qu’à l’aube, quand l’air est encore frais. Une heure plus tard, sa fragrance s’altère.
La rose de mai offre sa floraison en trois semaines, pas plus. Il faut la récolter fleur par fleur, avec une patience qu’on n’invente pas.
La tubéreuse, capricieuse et généreuse à la fois, demande un sol bien drainé et une attention de tous les instants.
Et puis la lavande, discrète mais puissante, pousse sur les hauteurs. Elle donne à l’ensemble sa touche aromatique et presque médicinale.
Rien de tout cela ne serait possible sans celles et ceux qui, ici, savent lire la terre et parler aux fleurs.
À Grasse, cultiver des fleurs, ce n’est pas un métier d’appoint. C’est un héritage, une mémoire transmise par le geste. On apprend tôt à reconnaître le bon moment, à sentir sans regarder, à trier sans abîmer. Ce savoir ne s’enseigne pas : il s’attrape, en regardant faire.
Ce sont ces gestes-là, appris sans manuel, qui forment le socle invisible mais essentiel de toute la filière. La plupart des producteurs travaillent en famille, souvent regroupés en coopératives. C’est une manière de rester solides, de faire corps, et de garantir une qualité sans compromis.
Certaines fermes, comme celle de Pégomas, ont tissé des liens étroits avec de grandes maisons. Depuis plusieurs décennies, Chanel s’approvisionne auprès de la famille Mul à Pégomas pour son jasmin et sa rose Centifolia, utilisés notamment dans la composition de N°5.
Aujourd’hui, la dynamique est claire : agriculture bio, circuits courts, retour au local. Grasse ne suit pas une tendance, elle défend sa propre cohérence.
Ici, on cultive bien plus que des fleurs. On cultive un équilibre entre la terre, le temps, le geste… et ce qu’on choisit d’en faire.
Un savoir-faire artisanal devenu industriel
L’histoire de la parfumerie à Grasse commence avec le cuir. Au XVIᵉ siècle, la ville, grâce à ses sources, est un centre actif de la tannerie. Le cuir tanné conservait une odeur forte, que certains artisans ont cherché à masquer avec des essences florales.
Le geste est d’abord utilitaire, puis devient un marqueur de distinction. Dès le XVIᵉ siècle, les gants parfumés gagnent en popularité auprès des élites européennes, notamment à la cour de France. Grasse, alors ville de ganterie, commence à se distinguer par ce savoir-faire naissant.
Cette activité annexe va peu à peu prendre son autonomie. Dès le XVIIᵉ siècle, la parfumerie se détache de la ganterie pour s’imposer comme une filière à part entière. Grasse bénéficie alors de deux atouts décisifs : la disponibilité locale de fleurs à parfum, et une main-d’œuvre habituée à transformer la matière avec minutie.
Les techniques d’extraction mises au point à cette époque continuent d’imprégner le savoir-faire grassois :
• La distillation à la vapeur, adaptée aux plantes robustes comme la lavande ou le romarin, permet d’extraire des huiles essentielles en chauffant la matière végétale.
• L’enfleurage à froid, procédé typique de Grasse, repose sur l’absorption des molécules odorantes par une graisse neutre, puis leur récupération par l’alcool. Cette méthode est particulièrement utilisée pour les fleurs délicates comme le jasmin ou la tubéreuse, qui ne supportent ni la chaleur ni la pression.
• La macération, qui consiste à laisser tremper les matières premières dans un solvant pendant plusieurs jours ou semaines, offre un autre mode de capture de l’odeur.
Pendant tout le XVIIIᵉ et XIXᵉ siècle, Grasse développe une véritable industrie du parfum, structurée autour de ces procédés. Les artisans deviennent des transformateurs, les exploitations agricoles se spécialisent, et les premiers négociants apparaissent. La ville devient un carrefour entre culture, technique et commerce, capable de répondre aux demandes croissantes de la parfumerie de luxe naissante.
Le XXᵉ siècle marque l’entrée dans une nouvelle phase : l’industrialisation maîtrisée. Grasse développe ses infrastructures, modernise ses outils, mais conserve ses fondements. Les petites structures familiales côtoient des maisons plus larges, les gestes manuels restent présents même au sein des unités de production. Ce double mouvement — fidélité aux techniques anciennes et adaptation à la demande mondiale — permet à Grasse de préserver sa singularité dans un secteur de plus en plus globalisé.
Aujourd’hui encore, malgré les progrès technologiques et l’arrivée de la chimie de synthèse, les grandes maisons et les parfumeurs indépendants continuent de s’appuyer sur les techniques traditionnelles grassoises. Parce qu’elles ne sont pas seulement efficaces : elles garantissent une qualité sensorielle et une profondeur olfactive qu’aucun procédé standardisé ne peut remplacer.
Le rayonnement international de Grasse
À partir du XIXᵉ siècle, Grasse change d’échelle. Ce n’est plus seulement une ville spécialisée dans la transformation des fleurs : c’est un nom qui circule, une référence qui s’impose. Son savoir-faire dépasse les frontières. Il ne se limite plus à ce que l’on produit localement, mais s’exprime dans chaque parfum qui revendique un ancrage d’excellence. Trois piliers structurent cette réputation : la culture des plantes à parfum, leur transformation, et l’art de les faire parler dans une composition. Grasse maîtrise les trois.
Ce rayonnement s’incarne d’abord à travers ses maisons historiques. Fragonard, Molinard, Galimard : toutes trois ont traversé les époques sans se figer. Elles conservent leur ancrage local, tout en ayant su ouvrir leurs portes au grand public. Leurs ateliers sont toujours actifs, mais elles ont aussi développé des musées, des parcours de visite, des collections accessibles. Leur rôle dépasse la simple préservation d’un patrimoine : elles participent à sa transmission, à sa compréhension, à sa réinvention. Elles ne préservent pas un décor, elles prolongent un geste.


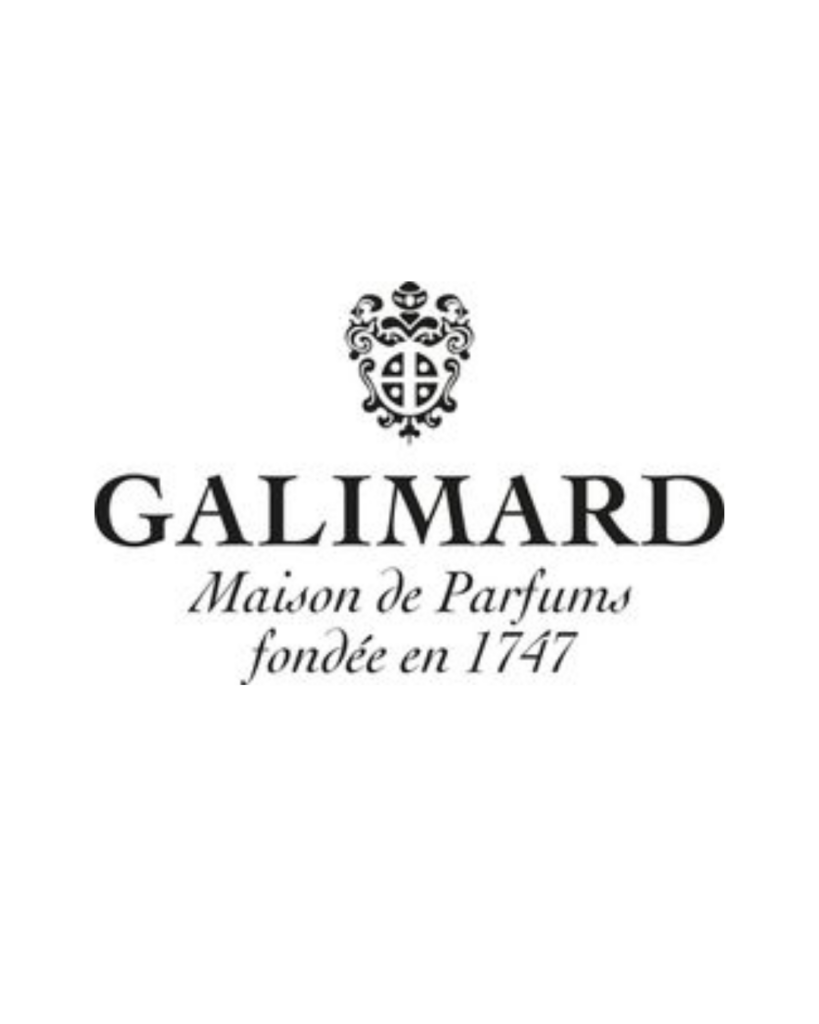
Mais le rayonnement de Grasse ne repose pas uniquement sur ses maisons. Il s’exprime aussi dans la qualité de ses fleurs, que les grandes maisons s’arrachent. Chanel, Dior, Guerlain, Hermès… toutes entretiennent des relations durables avec les producteurs grassois. Certaines vont plus loin encore, comme Chanel, qui depuis plusieurs décennies collabore en exclusivité avec la famille Mul, à Pégomas. C’est là que sont cultivés chaque année le jasmin et la rose Centifolia utilisés dans les formules les plus emblématiques de la maison. Ce type de partenariat repose sur un double engagement : une qualité constante d’un côté, une sécurité économique de l’autre. C’est ce lien de confiance qui permet de maintenir des cultures traditionnelles, sans compromis sur les pratiques.
La maison Dior a collaboré avec Edmond Roudnitska, installé à Cabris, pour plusieurs de ses compositions emblématiques. Si Cabris n’est pas un site de production pour la marque, il reste symboliquement lié à cette période de création.
Lancôme avec le Domaine de la Rose, un lieu dédié à la culture biologique de la rose centifolia, symbole de la marque, alliant tradition, innovation et engagement écologique.
Aurélien Guichard, co-fondateur de Matière Première, cultive sur un domaine biologique certifié Ecocert dans la région de Grasse, des champs de rose centifolia, de tubéreuse et de lavandin afin de produire lui-même ses ingrédients naturels — ce qui fait de lui le seul parfumeur au monde à maîtriser ainsi toute la filière de la matière première.
Dans tous les cas, l’intention est la même : préserver une proximité réelle entre la création olfactive et le vivant. Les parfumeurs, qu’ils soient maison ou indépendants, viennent à Grasse pour sentir, échanger, choisir. Ils marchent dans les champs, discutent avec les cultivateurs, respirent l’air du lieu. Cette expérience directe, presque rituelle, participe de la justesse du geste créatif.
Ce lien organique entre une terre et une industrie a été reconnu officiellement en 2018. Cette année-là, l’UNESCO inscrit les savoir-faire liés au parfum en Pays de Grasse au patrimoine culturel immatériel de l’humanité. Ce n’est pas une simple distinction symbolique : c’est la reconnaissance d’une chaîne complète, de la plante au parfum. L’inscription honore la culture des fleurs, leur transformation, mais aussi la manière dont ces matières deviennent langage, dans une logique de transmission intergénérationnelle. Elle valorise un savoir-faire vivant, qui articule nature, technique et économie locale. Grasse devient ainsi le premier territoire au monde à recevoir une telle reconnaissance dans le domaine du parfum.
Aujourd’hui, le nom de Grasse ne désigne plus uniquement un lieu. Il évoque une promesse : celle d’un parfum construit avec exigence, authenticité et maîtrise. Dans les circuits professionnels comme dans l’imaginaire du luxe, Grasse reste une signature.
Grasse aujourd’hui : entre tradition et innovation
Alors que la parfumerie mondiale traverse une période de questionnements sur son impact, ses sources, ses responsabilités ; Grasse continue d’avancer. Elle le fait à son rythme, sans rupture spectaculaire, mais sans immobilisme non plus. Fidèle à elle-même, elle bouge sans renier. Elle ajuste, sans jamais renoncer à ce qui fait sa colonne vertébrale.
Protéger ses cultures florales reste une priorité concrète, pas un discours. Face à la pression des terrains qui se vendent plus vite qu’ils ne se replantent, face à la concurrence venue d’ailleurs, les producteurs s’organisent. Beaucoup ont choisi de se regrouper en coopératives, pour ne pas porter seuls le poids de la saison ou du marché. Le bio s’impose de plus en plus, pas seulement parce que c’est tendance, mais parce que le sol, lui aussi, a besoin de temps, de justesse, de respect. Les circuits courts se développent : pour garantir la qualité, mais aussi pour redonner du sens à chaque étape.
Transmettre, ici, est un verbe d’action. Il se conjugue à tous les âges. À l’École supérieure du parfum, au lycée horticole, ou dans les formations continues soutenues par les maisons, on apprend en regardant faire. La transmission du savoir-faire à Grasse repose en grande partie sur l’observation, l’expérience et la répétition des gestes au quotidien.
Les musées, les ateliers, les parcours olfactifs grand public ouvrent aussi des portes : parce que la parfumerie ne doit plus rester l’affaire de quelques-uns. À Grasse, la culture du parfum se transmet à la fois dans les champs, dans les ateliers et dans les lieux de formation, une transmission concrète enracinée dans le territoire.


Mais la tradition, ici, ne signifie jamais le repli. L’innovation a toute sa place à condition qu’elle respecte le geste. Plusieurs structures de recherche travaillent depuis Grasse sur des sujets concrets : chimie verte, extraction douce, molécules alternatives. L’objectif n’est pas de remplacer la nature, mais d’inventer des solutions là où certaines matières deviennent trop rares, ou trop réglementées.
La question de la durabilité est désormais centrale. Et elle ne se limite pas aux ingrédients.
Plusieurs acteurs locaux s’intéressent aujourd’hui à la durabilité : extraction plus économe, solvants d’origine naturelle, et réflexion sur des emballages plus responsables.
On croise ici les savoirs : ceux de l’artisan, de l’industriel, du chercheur. Ce croisement est fertile. Il dessine un autre modèle, à la fois exigeant et adaptable.
Grasse ne repose pas uniquement sur son héritage. Elle le remet en jeu, chaque saison, chaque récolte, chaque création en réaffirmant la vitalité de son écosystème. Ce qui la maintient vivante, c’est cette tension fertile entre ce qu’elle protège et ce qu’elle explore. Fidélité et mouvement. Héritage et projection.
Et c’est peut-être cela, au fond, qui fait qu’on continue de l’appeler la capitale du parfum sans réserve ni nostalgie.
De ses collines de jasmin aux laboratoires de chimie verte, Grasse incarne une parfumerie complète, exigeante, et résolument vivante. Là où d’autres territoires ont vu leur savoir-faire s’éteindre ou se diluer, Grasse a su s’adapter sans céder à la standardisation. C’est cette capacité à concilier geste ancien et vision nouvelle qui fait aujourd’hui encore sa force.
Alors que les enjeux écologiques et économiques redessinent les contours du secteur, Grasse offre un modèle précieux à observer : une ville qui ne vend pas une image, mais un ancrage. Une ville qui ne préserve pas seulement un passé, mais qui continue d’inspirer l’avenir.

