
Le parfum en podcast 🎙️
Les vacances d’été, le moment est idéal pour se ressourcer autrement. Le parfum, art de l’invisible, s’écoute. Les podcasts spécialisés offrent une plongée sonore dans l’univers olfactif, sans besoin de flacon. C’est une invitation au voyage intérieur et à la connaissance, rien qu’avec la voix.
Une émergence récente, entre sens et récit
Le parfum n’a jamais été un sujet facile à traduire. Trop sensoriel pour l’écrit, trop invisible pour l’image, trop complexe pour les formats courts. Longtemps, il s’est glissé entre les lignes, à la marge des récits culturels. On en parlait dans les coulisses, entre spécialistes, dans des revues confidentielles ou lors de conférences professionnelles. Jamais dans l’espace grand public, et encore moins dans des formats audio.
La radio, puis le podcast, ont d’abord ignoré cette matière. Il y avait un malentendu : comment parler de ce qu’on ne peut ni voir ni entendre ? L’olfaction, dans l’imaginaire collectif, restait une affaire de marketing ou de poésie. Soit une industrie opaque, soit un territoire vague de sensations. Entre les deux, peu d’espace pour une parole rigoureuse et incarnée.
C’est à partir des années 2018–2019 qu’un changement lent mais significatif s’est amorcé. Plusieurs facteurs ont joué. D’abord, la montée en puissance du podcast comme média de fond, favorisant les formats longs, les récits personnels, l’approche sensible. Ensuite, la volonté de certains professionnels du parfum, journalistes, parfumeurs, créateurs ou passionnés, de sortir du cloisonnement technique.
Il y a aussi un contexte culturel plus large. Depuis la pandémie, le besoin de ralentir, d’écouter, de se reconnecter à des formes d’attention plus subtiles, a ouvert la voie à d’autres manières de parler du sensoriel. Le goût, le toucher, l’odeur ont retrouvé une place dans les conversations. Le parfum, en tant qu’objet culturel, a cessé d’être cantonné au produit pour redevenir un langage, une mémoire, et même le reflet du monde.
C’est dans ce moment-là que le podcast s’est imposé comme un médium pertinent. Dans une optique claire : explorer. Ce que permet le format audio, c’est une écoute sans distraction, un lien direct avec une voix, une émotion. La parole olfactive, souvent fragmentée ou muette, y trouve un terrain propice. On peut alors prendre le temps de déplier un souvenir d’enfance autour d’une odeur, retracer l’histoire d’une molécule oubliée, interroger un parfumeur sur ce qu’il n’ose pas toujours dire dans les médias classiques.
Et surtout, le podcast permet de dire autrement. Pas avec des fiches produit, pas avec des campagnes visuelles, mais avec le souffle de quelqu’un qui raconte, doute, hésite, se souvient. C’est cette parole-là que le parfum attendait.
Alors non, on ne sent pas à travers un podcast. Mais on écoute, et dans cette écoute naît autre chose. Une relation avec l’odeur. Une idée du parfum. Une sensation, toujours impalpable avec une nouvelle dimension.
Typologies de contenus, ou la diversité des approches
Quand on explore les podcasts consacrés au parfum, on découvre vite qu’il n’existe pas un seul type de discours olfactif. Il n’y a pas de format canonique, ni de modèle unique. Au contraire, ce qui frappe, c’est la diversité des intentions. Certains vont chercher la rencontre humaine, d’autres préfèrent l’analyse technique. Certains racontent des histoires, d’autres font parler les lieux, les matières, les gestes. C’est ce qui rend ce champ vivant.
Les entretiens avec les créateurs, parfumeurs, producteurs sont souvent le point d’entrée. Ils donnent une voix aux artisans de l’invisible.
- La Voix du Parfum, animée par Isabelle Sadoux, est l’un des podcasts les plus réguliers dans ce registre. Chaque mois, elle invite un acteur ou une actrice de la filière : parfumeurs, producteurs de plantes à parfum, artisans de la distillation. Loin des discours formatés, ces échanges laissent place aux doutes, aux silences, à la précision d’un souvenir ou d’un geste. On y découvre les coulisses de la création, mais aussi ce qui la précède : la terre, le climat, les mains.
- Dans un autre style, la série Jean-Claude Ellena : Le nez au vent, initiée par France Culture, retrace à la première personne la trajectoire d’un parfumeur à travers les paysages, les matières et les souvenirs qui l’ont façonné. Ce sont des formats rares mais précieux, qui ancrent le parfum dans le temps, dans le vécu.

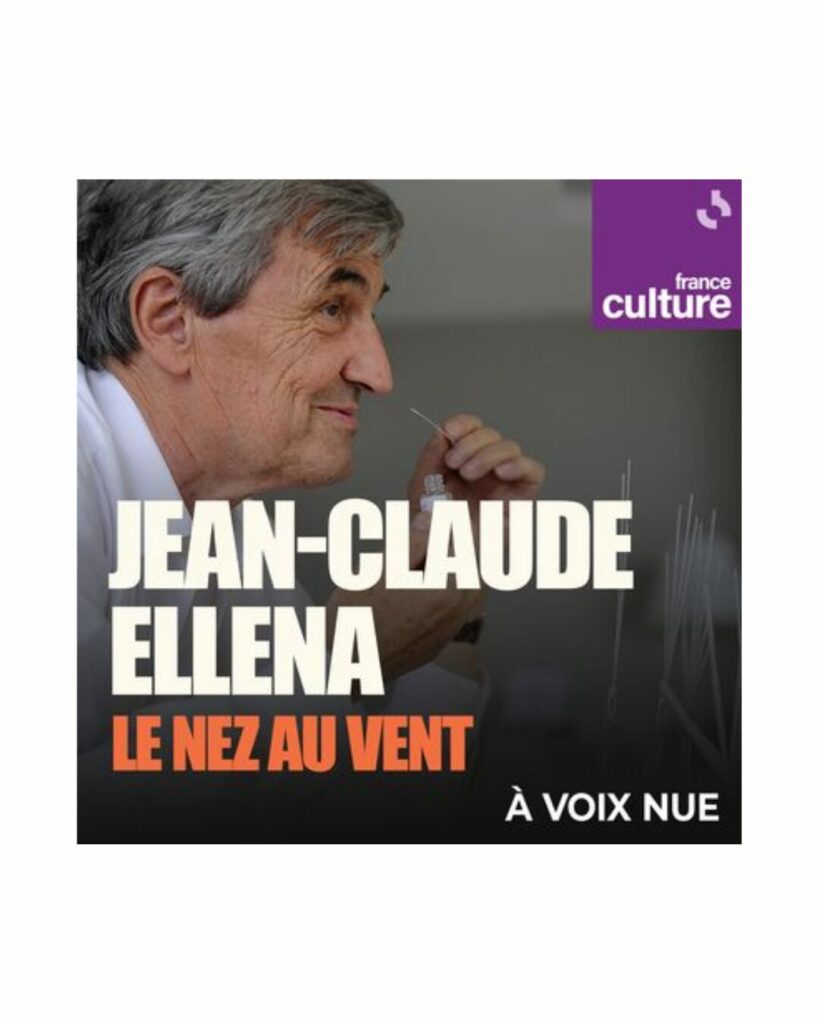
Plus rares, mais tout aussi essentiels, les podcasts qui abordent l’actualité du secteur et ses tendances commencent à se faire une place.
- Podcasts by Nez, produit par le collectif du même nom, propose des formats journalistiques, souvent en table ronde ou en entretien, pour interroger les mutations du marché. Émergence des parfums dits de niche, redéfinition du genre en parfumerie, impact des nouvelles réglementations, évolution des goûts olfactifs : ces sujets demandent de la rigueur, et trouvent ici un espace à la hauteur
Enfin, certains podcasts s’attachent à explorer la culture et l’histoire du parfum.
- C’est le cas d’À Fleur de Nez, produit en partenariat avec Fragonard, qui alterne entre récits historiques, approches scientifiques et récits sensibles.
- Nez à Nez adopte une forme encore plus libre, en invitant des anonymes à raconter une histoire personnelle liée à une odeur. L’objectif n’est pas de commenter un parfum, mais de révéler ce que l’odorat garde en mémoire, parfois depuis l’enfance.


Cette diversité de formats, de tons et de regards constitue une richesse. Elle reflète ce que le parfum est en réalité : un champ de perceptions lié au savoir et au récit. Le podcast, par sa plasticité et son intimité, permet à chacun d’y trouver un chemin. Que l’on soit amateur ou professionnel, curieux ou passionné, il y a, dans cette offre foisonnante, mille façons d’entrer en relation avec ce qui ne se voit pas.
Marques vs indépendants : deux registres, deux intentions
Dans le paysage des podcasts consacrés au parfum, deux grandes logiques éditoriales se dessinent. D’un côté, des formats produits par les marques, porteurs d’une parole maîtrisée, alignée sur leur esthétique et leurs valeurs. De l’autre, des voix indépendantes, plus libres dans leur ton, souvent plus critiques, mais pas pour autant exemptes de stratégie. Le clivage n’est pas une opposition frontale, mais un écart de posture, de rythme, d’intention.
Les podcasts de marque s’apparentent à des extensions sensorielles de leur univers.
- Fragrance Stories, lancé par Serge Lutens, illustre cette démarche avec précision : chaque épisode déroule une narration lente, feutrée, parfois quasi-mystique, dans la lignée de l’identité visuelle et littéraire de la maison. Ici, le podcast n’explique rien, il enveloppe. Il ne décrit pas le parfum, il en déploie les résonances. On est ici dans un registre narratif maîtrisé.
- À l’inverse, Essential Parfums adopte un ton plus clair, presque didactique. Les matières premières y sont racontées par les parfumeurs eux-mêmes, dans un format épuré, où la parole transmet sans surcharger. Ce n’est pas une plongée dans l’imaginaire, mais un geste de pédagogie maîtrisée. L’intention est noble : éveiller la curiosité, transmettre un savoir, sans bruit superflu.
En miroir de ces récits calibrés, les voix indépendantes occupent un espace plus mouvant, plus abrupt parfois, mais toujours nécessaire.
- La Parfumerie Podcast, animé par L’Ancien et Le Zen, s’inscrit dans cette veine. C’est brut, passionné, parfois dérangeant. Les épisodes ressemblent à des conversations entre amis, où se croisent coups de cœur, coups de gueule et analyses spontanées. Il n’y a pas de ligne figée, mais une parole assumée, subjective, presque militante. C’est ce souffle-là qui remet en mouvement un discours olfactif parfois trop lissé.
- Plus analytique, Podcasts by Nez, lancé en 2021 par le collectif éponyme, structure la parole autour de thématiques précises : le genre, l’économie, la culture du parfum. Tables rondes, lectures commentées, entretiens croisés : tout y est pensé pour décloisonner. Le ton est rigoureux, parfois aride, mais toujours situé. C’est un espace où le parfum s’articule avec le monde, sans effet de style inutile.
- Enfin, Sens Figuré, porté par Anne-Laure Joalland, propose une alternative sensible. Chaque épisode est construit autour d’une voix, d’un souvenir, d’un rapport intime à l’odeur. On y entend peu de marques, peu de termes techniques, mais beaucoup de vécu. L’émotion n’y est pas exploitée : elle est accueillie. Dans ce format, le podcast devient presque un geste poétique. Une forme d’archéologie intérieure, où le parfum révèle ce qu’il enfouit.


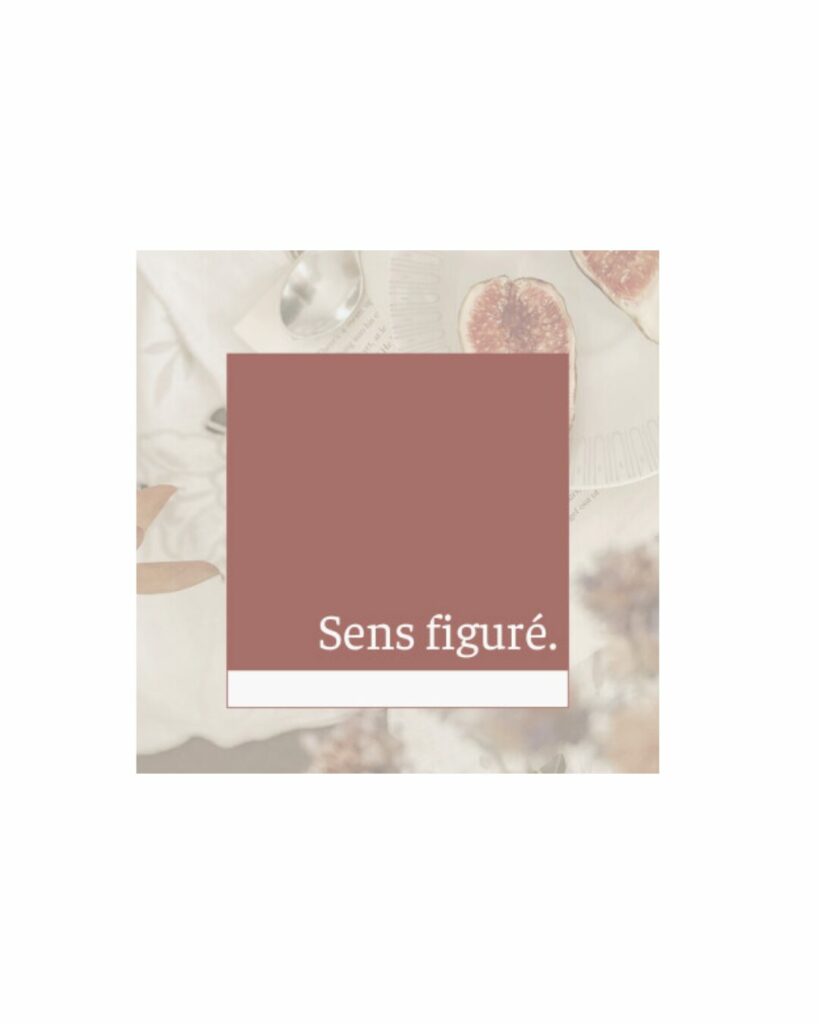
Ce qui se dessine, ce n’est pas une hiérarchie entre formats contrôlés et voix libres, mais une coexistence de récits. Chaque podcast trace sa ligne, selon ses ressources, ses objectifs, ses fidélités. Ce qui compte, au fond, ce n’est pas l’origine du podcast, mais la justesse de ce qu’il tente. La cohérence entre le fond et la forme, l’honnêteté du ton, l’attention portée à ce qui se dit… et à ce qui ne se dit pas.
Limites et défis du format
Parler de parfum sans le faire sentir. C’est tout l’enjeu. Et tout le paradoxe.
Le podcast impose une contrainte évidente : l’absence d’odeur. Là où le parfum repose sur la volatilité, l’instant, la peau, le format audio ne transmet rien de la matière réelle. Il ne donne accès ni à la sensation directe, ni à l’effet de sillage, ni à l’évolution sur l’épiderme. Ce manque est frontal. Il ne peut pas être contourné.
Mais c’est précisément cette limite qui pousse ceux qui s’en emparent à inventer autre chose. Le podcast n’essaie pas de simuler le parfum. Il ne cherche pas à combler le vide, mais à composer avec lui. Il faut alors faire confiance au langage, aux silences, aux images mentales que les mots peuvent réveiller.
Le défi principal reste celui du vocabulaire. Parler d’odeur est toujours délicat. Trop de mots techniques, et on perd l’auditeur. Trop de métaphores, et on flotte. Il faut trouver un équilibre rare entre précision et évocation, entre rigueur et sensibilité. Ceux qui y parviennent réussissent à faire ressentir quelque chose, sans rien imposer. Les autres s’égarent dans des généralités ou dans des détours qui fatiguent.
Autre difficulté : le public. Le parfum est un domaine encore souvent perçu comme élitiste ou trop abstrait. Les podcasts doivent composer avec ce filtre. Le risque est double. D’un côté, rester trop confidentiel. De l’autre, simplifier à l’excès. Trouver sa place entre ces deux extrêmes demande du temps, une identité claire, et une vraie constance dans le propos.
Et puis, il y a la question du rythme. Le parfum appelle la lenteur, la profondeur, la nuance. Or, le podcast reste un format soumis à la disponibilité de l’auditeur, à sa concentration, à sa fatigue aussi. Il faut donc capter l’attention sans trahir la matière. Éviter l’effet « monologue figé », tout en refusant le bavardage gratuit.
Ce n’est pas un format évident. Il exige un engagement sincère, une capacité d’écoute, une attention au détail. Mais c’est aussi ce qui en fait sa force. Parce qu’il ne montre rien, le podcast ouvre un espace imaginaire. Ce qu’on n’entend pas, on le devine. Ce qu’on ne sent pas, on le projette.
Les créateurs qui acceptent la règle du jeu de parler sans montrer, suggérer sans saturer, offrent alors une expérience unique. Une autre façon d’entrer dans l’univers du parfum. Plus discrète. Plus intérieure. Mais parfois plus marquante que bien des discours illustrés.
Le podcast n’essaie pas de prendre la place de l’odeur mais plutôt de construire une relation plus lente, plus intérieure. Une parole qui prend le temps de se poser.
Ces formats cherchent à mettre en avant ce qui, d’habitude, ne fait pas de bruit. Une manière de créer du lien avec le parfum, non plus par la peau, mais par l’écoute.
Le format reste jeune. Mais il trace déjà des chemins. Demain, peut-être, l’expérience se prolongera. Un podcast accompagné d’un échantillon. Une narration pensée pour les sens. Une exploration croisée, où l’oreille et le nez avanceraient ensemble.
Et voilà déjà une autre manière d’habiter le parfum.

