Les tropiques, avec leur luxuriance naturelle et leur diversité olfactive, sont une source d’inspiration inépuisable pour les parfumeurs du monde entier. Les notes olfactives tropicales apportent une touche solaire, fruitée et florale tropicale à chaque fragrance. Explorons ces notes en détail et découvrons comment elles sont utilisées en parfumerie pour créer des sensations olfactives uniques.

Les Notes Fruitées et Ensoleillées 🥭🍍🥥
La tendance de parfums fruités tropicaux dans les parfums nous vient du Brésil dans les années 90.
Dans la culture brésilienne, la tradition a longtemps été de s’inonder de “bahno de cheiro”, des infusions de plantes rafraîchissantes et mystiques pour le corps. Dans nos temps plus modernes, la tradition du splash parfumé utilisé à titre purement hédoniste après la douche a pris le dessus sur ces infusions purificatrices. Les notes de fruits tropicaux, dont regorge le pays (fruit de la passion/maracuya, açai, ananas, coco…), ont remplacé ou bien se sont mêlés aux plantes ancestrales aux multiples vertus.
Les fruits ne pouvant offrir leurs essences aromatiques du fait de leur trop grande teneur en eau, les parfumeurs ont recréé ces odeurs grâce à des molécules de synthèse:
Et c’est ainsi qu’à partir des années 90, les notes de fruits tropicaux sont apparues, d’abord dans les produits d’hygiène, aux Etats-Unis d’abord par le biais de la marque américaine Bath and Body Works, puis petit à petit dans nos flacons de parfums pour apporter leur joie, leurs couleurs et leur énergie réminiscentes des carnavals brésiliens.
Les notes fruitées sont souvent utilisées dans les parfums pour femmes, mais elles apparaissent également dans les compositions unisexes et masculines pour ajouter une dimension fraîche et vivifiante. Elles sont particulièrement populaires dans les parfums estivaux et les eaux de toilette légères, où elles apportent une sensation de légèreté et de joie. Les parfumeurs les combinent souvent avec des notes florales, boisées ou épicées pour créer des compositions équilibrées et harmonieuses.
Mangue
La mangue est une note juteuse et douce qui apporte une sensation de fraîcheur tropicale , ronde , juteuse et crémeuse. Originaire d’Asie du Sud, la mangue est riche en nuances sucrées et légèrement acidulées. En parfumerie, elle est souvent utilisée pour ajouter une touche gourmande et ensoleillée aux compositions.
Fame de Paco Rabanne utilise la mangue pour créer une fragrance estivale et gourmande, hyper addictive.
Ananas
L’ananas est un fruit emblématique des tropiques, originaire d’Amérique du Sud. Son parfum frais, sucré et légèrement acidulé est parfait pour les parfums dynamiques et rafraîchissants. L’ananas apporte une touche d’exotisme et de vivacité aux compositions parfumées. Associé à la coco, il apporte une note piña colada festive.
Dolce & Gabbana Pineapple est un excellent exemple de parfum utilisant cette note pour évoquer une sensation de vacances exotiques et de plaisir sous le soleil.
Noix de Coco
La noix de coco, avec son odeur crémeuse et lactée, est incontournable pour évoquer les plages des îles tropicales. Elle apporte une dimension douce, réconfortante et exotique aux parfums solaires. Utilisée souvent dans les compositions estivales, elle rappelle immédiatement les vacances au bord de la mer.
Le Beau de Jean-Paul Gaultier intègre en coeur cette note pour ajouter une profondeur tropicale à sa pyramide sophistiquée et boisée, et Bronze Goddess d’Estée Lauder en fait un usage plus prononcé et ambré pour un effet purement estival.

Papaye
La papaye est un autre fruit tropical très apprécié en parfumerie pour sa douceur tropicale. Originaire des régions tropicales d’Amérique centrale et du Sud, la papaye offre des notes sucrées, juteuses et légèrement musquées.
Papaye Paradise Cove de Bath & Body Works utilise la papaye parfaite pour rappeler une journée à la plage douce et calme.
Goyave
La goyave, avec son arôme sucré et légèrement floral, est une note fruitée moins courante mais tout aussi exotique. Originaire des régions tropicales d’Amérique centrale, la goyave apporte une touche tropicale unique aux compositions parfumées.
Delta Of Venus de la maison Eris est un parfum floral vert ou la note de papaye en fond intensifie l’aspect exotique de la fragrance.
Fruit de la Passion
Le fruit de la passion est une note intense et parfumée qui apporte une sensation de fraîcheur et de gourmandise aux parfums. Originaire des régions tropicales d’Amérique du Sud, ce fruit est connu pour son arôme sucré, acidulé et légèrement floral.
Arancia Rossa de Laboratorio Olfattivo est un hespéridé ou la note de fruit de la passion donne un twist exotique à une fragrance rafraichissante.
Les Notes Florales des Tropiques 🌺
Les notes florales des tropiques sont souvent utilisées comme notes de cœur dans les compositions parfumées pour leur richesse en alliant une dimension sensuelle et envoûtante. Elles sont combinées avec des notes fruitées, boisées ou épicées pour créer des fragrances équilibrées et harmonieuses.
Que ce soit pour évoquer la douceur des îles ou la richesse de la végétation tropicale, les fleurs des tropiques jouent un rôle crucial dans l’art de la parfumerie.
Ylang-Ylang
L’ylang-ylang, dont le nom signifie « fleur des fleurs », est originaire de Madagascar, des Comores et des Philippines. Cette fleur jaune en forme d’étoile est connue pour son parfum enivrant, sucré et légèrement épicé. L’huile essentielle d’ylang-ylang est extraite par distillation à la vapeur des fleurs fraîches, produisant différentes fractions selon la durée de la distillation, chacune ayant des nuances olfactives distinctes.
L’ylang-ylang est souvent utilisé dans les compositions florales, orientales et chyprées pour ajouter une dimension exotique et sensuelle. Il peut également être trouvé dans les parfums solaires, évoquant la chaleur et la douceur des îles tropicales.
Mon Guerlain de la maison éponyme utilise l’ylang-ylang pour enrichir son bouquet floral, apportant une touche de luxe exotique et crémeuse.
Frangipanier
Le frangipanier, également connu sous le nom de plumeria, est une fleur tropicale emblématique des îles du Pacifique, d’Amérique centrale et des Caraïbes. Son parfum est doux, sucré et légèrement crémeux, souvent associé à une sensation de pureté et de sérénité.
Le frangipanier est apprécié pour sa douceur exotique dans les compositions florales. Il est souvent utilisé dans les parfums pour femmes, apportant une note délicate et apaisante.
Frangipani Flower Cologne de Jo Malone est une fragrance lumineuse et exotique, inspirée par la beauté envoûtante de la fleur de frangipanier. Avec ses notes fraîches et boisées, cette cologne offre une évasion sensorielle incarnant la beauté naturelle et envoûtante des fleurs tropicales.
Gardénia
Le gardénia est une fleur tropicale originaire d’Asie et des îles du Pacifique. Son parfum est riche, capiteux et légèrement épicé, souvent décrit comme étant intensément floral avec des nuances crémeuses.
Le gardénia est utilisé dans les parfums pour apporter une profondeur florale luxuriante et sensuelle.
Velvet Gardenia de Tom Ford met en avant cette fleur somptueuse alliée à des accords de miel et de prune, la rendant divinement addictive et envoûtante.




Tiaré
La fleur de tiaré, ou gardénia tahitensis, est originaire de Polynésie française et est un symbole de beauté et de pureté. Il parfume la célèbre huile de monoï. Son parfum est doux, crémeux et légèrement sucré, avec des nuances florales délicates. Le tiaré est souvent utilisé dans les parfums solaires et floraux pour évoquer des plages paradisiaques et des journées ensoleillées.
Sunkissed Goddness de By Kilian est un ambré floral ou la fleur de tiaré alliée àa l’ylang-ylang propose un parfum chaud et sensuel.
Hibiscus
L’hibiscus est une fleur tropicale présente dans de nombreuses régions chaudes du monde, notamment en Asie, en Afrique et dans les Caraïbes. Son parfum est doux, légèrement fruité et floral.
L’hibiscus est souvent utilisé pour apporter une touche légère et exotique aux compositions florales.
Hibiscus Paradise de Bath & Body Works est un parfum ou la fleur d’hibiscus au cœur va donner une fraîcheur florale à un ensemble fruité gourmand
Le jasmin Sambac
Le jasmin Sambac, également connu sous le nom de jasmin d’Arabie, est originaire d’Asie du Sud-Est. Cette variété de jasmin est plus fruitée et sucrée que le jasmin grandiflorum, avec des nuances légèrement épicées.
Le jasmin sambac est utilisé pour ajouter une profondeur florale exotique et enivrante aux compositions parfumées.
Alien de Mugler utilise cette note pour créer une fragrance mystérieuse, ambrée et musquée, évoquant la beauté envoûtante des tropiques.
Les Notes de Vanille ☀️
La vanille est l’une des matières premières les plus prisées en parfumerie, reconnue pour son odeur douce, riche et enveloppante. Originaire des régions tropicales, la vanille apporte une chaleur réconfortante et une profondeur gourmande aux compositions parfumées.
La vanille de Madagascar, souvent appelée vanille bourbon, est la variété la plus célèbre et la plus utilisée en parfumerie. Cette vanille provient de l’orchidée Vanilla planifolia, cultivée principalement sur l’île de Madagascar, qui produit environ 80 % de la vanille mondiale. Les gousses de vanille bourbon sont connues pour leur richesse odorante, crémeuse et sucrée, avec des nuances légèrement épicées.
La production de vanille à Madagascar est un processus artisanal complexe. Les fleurs de vanillier sont pollinisées à la main, et les gousses, une fois récoltées, subissent une série de traitements incluant l’échaudage, la fermentation, le séchage et le conditionnement, afin de développer leur arôme caractéristique.

Serge Lutens – Un Bois Vanille Cette fragrance utilise la vanille de Madagascar pour créer une douceur crémeuse, enrichie de notes de bois de santal, de réglisse et de caramel.
La vanille tahitensis, cultivée principalement en Polynésie française, notamment à Tahiti, est une autre variété précieuse. Cette vanille provient de l’orchidée Vanilla tahitensis et se distingue par ses gousses plus courtes et plus larges. Son arôme est plus floral, fruité et exotique, avec des nuances de cerise et d’amande.
La production de la vanille tahitensis suit également des méthodes artisanales rigoureuses, et bien que sa production soit moins abondante que celle de Madagascar, elle est très appréciée pour ses qualités uniques.
Les Indémodables – Vanille Havane
Cette fragrance met en avant la vanille tahitensis avec des accords de tabac, de miel et de rhum, créant une composition riche et exotique.
Les notes olfactives des tropiques offrent une évasion sensorielle unique. Que ce soit à travers des notes fruitées et ensoleillées, des fleurs enivrantes ou des vanilles gourmandes, les parfumeurs continuent de s’inspirer des tropiques pour créer des fragrances qui transportent les sens vers des horizons lointains et paradisiaques.
Article co-écrit par Elfa et Anne-Laure
La Rose Damascena, est un joyau botanique connu pour son parfum enivrant et ses huiles précieuses. Dans cet article, nous plongerons dans l’origine géographique et botanique de cette fleur emblématique, son histoire riche, les méthodes d’extraction de son essence, ses facettes olfactives uniques, sa distinction par rapport à la rose Centifolia, et enfin, nous explorerons quelques parfums iconiques qui la mettent en vedette.

Origines géographique et botanique
La rose Damascena, couramment appelée rose de Damas, porte le nom de l’antique ville de Damas en Syrie, Mais sa véritable origine est Shiraz en Iran (ancienne Perse).
Il s’agit d’un hybride de Rosa Gallica, Rosa Moschata et Rosa Fedtschenkoana, originaire d’Asie centrale et de Chine.
Botaniquement classée sous le nom de Rosa Damascena, cette rose appartient à la famille des Rosaceae. Elle se présente généralement sous la forme d’un arbuste robuste pouvant atteindre jusqu’à 2 mètres de hauteur.
Ses feuilles sont d’un vert foncé lustré, et ses fleurs, qui fleurissent en début d’été, varient en couleur du rose pâle au rouge profond. Chaque fleur est composée de multiples couches de pétales, ce qui lui donne une apparence très dense et voluptueuse.
Elle a voyagé de Shiraz à Damas, grand centre commercial de la Méditerranée au Moyen Âge.
Les croisades au Moyen-Âge ont facilité son introduction en Europe. Baptisée “rose de Damas” où elle a été adoptée avec enthousiasme dans les jardins botaniques royaux et les apothicaires pour ses vertus thérapeutiques et son parfum enchanteur.
Du Proche-Orient, la rose de Damas a également fait un voyage vers l’est jusqu’en Inde et en Chine où on la trouve et la cultive encore aujourd’hui.
Les musulmans perses ont inventé l’eau de rose au cours du VIIIe siècle et en parfumeront l’Asie et le monde pendant environ 8 siècles.
Entre le XVème et le XVIème siècle, l’Empire Ottoman fait un grand usage de la rose de Damas: dans sa pharmacopée pour ses propriétés médicinales (migraines, maux d’estomac, maladies des yeux ou des poumons…).
On peut l’ingérer ou s’en oindre en pommade. L’eau de rose est aussi utilisée pour ses propriétés cosmétiques tonifiantes et désodorisantes et on l’incorpore également dans des mets alimentaires, salés ou sucrés. Elle sert aussi à purifier le foyer. Avec le qumqum (asperseur), on lavait les mains des visiteurs en guise de bienvenue.
Au XVe siècle, le sultan Murad III, ne voulant pas dépendre uniquement de la Perse pour approvisionner son palais de Constantinople (aujourd’hui Istanbul) en pétales et en eau de rose, il demande à son jardinier de commencer à cultiver ces roses de Damas dans sa province d’Edirne (l’actuelle Bulgarie) qui s’avère une zone climatique idéale pour sa floraison.
Lorsque la Bulgarie acquiert son indépendance en 1880, elle revendique l’invention de l’essence de rose moderne par le principe de la double distillation. (l‘eau de la première distillation est à nouveau distillée: voir plus bas)
Dès lors, la rose bulgare a dominé le marché jusqu’au XXème siècle. Son règne est tombé avec la crise résultant de la chute de l’URSS..
Aujourd’hui, la rose de Damas utilisée en parfumerie provient principalement de Turquie, même si elle est encore cultivée dans d’autres pays comme la Bulgarie, le Maroc, l’Inde, l’Égypte, l’Iran et la Chine.
La popularité de la rose Damascena en tant que source d’huile essentielle a donné lieu à des techniques de culture spécialisées pour maximiser la production d’huile. Les régions de la vallée de Kazanlak en Bulgarie et de la ville d’Isparta en Turquie sont particulièrement célèbres pour leurs festivals annuels de la rose, qui célèbrent la récolte des fleurs et la production d’huile de rose. Ces festivités mettent en avant non seulement l’importance économique de la rose, mais aussi son rôle dans le patrimoine culturel de ces régions.
Méthodes d’Extraction
L’extraction de l’huile essentielle (aussi appelée essence) de la rose Damascena et de son eau est un art qui a été raffiné au fil des siècles, combinant tradition et innovation technologique pour parvenir à capturer le parfum délicat et complexe de cette fleur emblématique. En parfumerie, les deux techniques les plus utilisées pour en extraire l’âme parfumée sont l’hydrodistillation et l’extraction aux solvants volatils.
L’hydrodistillation
Pas de distillation à la vapeur d’eau qui pourrait coller entre eux les pétales délicats de la fleur. C’est l’hydrodistillation qui est privilégiée pour extraire l’huile essentielle et l’eau de rose Damascena.
Le processus commence au lever du jour, lorsque les roses sont cueillies à la main pour garantir la fraîcheur et la qualité des pétales. Ces pétales sont ensuite placés dans de grandes cuves de distillation dans lesquelles on ajoute de l’eau. On porte à ébullition, afin de générer une vapeur qui va se charger des composés odorants des fleurs. Cette vapeur odorante est ensuite refroidie dans un serpentin qui va la condenser pour la ,e transformer en un liquide qui contient à la fois de l’eau et de l’huile essentielle.
Ce liquide est versé dans un vase florentin, où l’huile, plus légère que l’eau, se sépare naturellement et flotte à la surface.
On recueille cette première huile et, selon la technique bulgare appelée “stripping”, on re-distille à la vapeur l’eau de rose obtenue.
Mais ce n’est pas tout! l’eau de cette deuxième distillation est aussi re-distillée, ce qui permet d’obtenir une 3ème HUILE ESSENTIELLE. Ce procédé permet d’obtenir plusieurs qualités d’huiles essentielles que l’on peut assembler.

Extraction aux solvants volatils
Ici, les pétales de rose sont placés dans une cuve sur plusieurs niveaux.
On remplit cette cuve avec un solvant (hexane) qui va venir “laver” les fleurs c’est-à-dire se gorger de leurs composants parfumés. Quand le solvant est saturé en parfum des fleurs, on l’extrait, on le filtre, puis on procède à son évaporation.
Une fois le solvant totalement évaporé, il ne reste plus qu’une cire parfumée saturée des composants parfumés des fleurs. Cette cire s’appelle CONCRÈTE.
Cette concrète peut-être utilisée telle quelle. Mais la majeure partie est fondue et lavée dans de l’alcool afin de se débarrasser des cires. Le produit alcoolisé obtenu est ensuite chauffé pour évaporer l’alcool et obtenir un produit parfumé pur appelé ABSOLU.
Choix de la Méthode
Le choix de la méthode d’extraction dépend souvent du produit final souhaité.
L’huile essentielle obtenue par hydrodistillation offre des facettes fruitées rappelant le litchi ou la framboise, et épicées. On l’utilise en parfumerie et en aromathérapie.
L’eau de rose: autre résultat de la distillation, fraîchement pétalée s’utilise en cosmétique et dans la cuisine.
L’absolu, au meilleur rendement, se parfume de facettes plus chaudes, sucrées, miellées.
Il existe aussi d’autres méthodes d’extraction pour obtenir des produits à base de rose: la macération dans l’alcool dont on obtient une infusion, l’extraction au CO2 (SFE = Supercritical Fluid Extraction : SFE) qui permet d’obtenir un extrait et le headspace qui permet de créer un accord. Mais les plus courantes restent l’hydrodistillaton et l’extraction aux solvants.
Bienfaits de la rose Damascena
La rose Damascena est reconnue pour ses nombreux bienfaits sur la santé et le bien-être.

Utilisée en aromathérapie, elle aide à réduire l’anxiété et le stress grâce à ses propriétés relaxantes et antidépressives.
Sur le plan émotionnel, l’essence de Rose Damascena est connue pour ouvrir le chakra du cœur ANAHATA, situé au niveau du sternum, associé à l‘amour, à la joie, à la paix intérieure, mais aussi à la tristesse et au désespoir… L’huile essentielle de rose damascena vient équilibrer le chakra du cœur afin de ramener la confiance en soi et en les autres.
En cosmétique, l’eau de rose et l’huile essentielle de rose Damascena sont prisées pour leurs effets hydratants, tonifiants et anti-inflammatoires, bénéfiques pour les peaux sensibles et aidant à prévenir les signes de vieillissement.
En médecine traditionnelle, la rose Damascena est également utilisée pour ses vertus toniques, notamment pour purifier le sang et aider à la digestion.
Ainsi, cette rose apporte une contribution significative à la santé physique et émotionnelle, renforçant le bien-être général.
Facettes Olfactives de la rose Damascena
La rose Damascena est universellement utilisée pour son profil olfactif complexe et profondément envoûtant, qui la distingue nettement dans l’univers de la parfumerie. Cette fleur offre un kaléidoscope de nuances olfactives qui peuvent varier légèrement selon le sol et les conditions climatiques où elle est cultivée, ainsi que les méthodes d’extraction employées.

Notes de Tête : Fraîcheur Délicate
Les notes de tête de la rose Damascena sont souvent décrites comme fraîches et légèrement sucrées, avec des accents de notes vertes. Cela peut évoquer la rosée du matin sur les pétales de rose, une sensation de pureté et de fraîcheur. Ces premières impressions olfactives sont légères et volatiles, s’évaporant rapidement.
Notes de Cœur : Richesse Florale
Au cœur du parfum de la rose Damascena se trouve une richesse florale intense. Les notes de cœur sont plus lourdes et persistent plus longtemps sur la peau. Cette facette du parfum est principalement florale, avec des nuances de miel et parfois, légèrement épicé. C’est ici que le parfum de la rose est le plus opulent et le plus reconnaissable, offrant une expérience sensorielle presque tactile de la fleur en pleine floraison grâce aux textures qu’elle évoque.
Notes de Fond : Subtilité et Profondeur
Les notes de fond de la rose Damascena révèlent une subtilité complexe, avec des nuances musquées et boisées qui s’ajoutent à la richesse de son parfum. Ces notes plus profondes fournissent une base solide sur laquelle le parfum peut s’épanouir, prolongeant la durée de vie du parfum sur la peau et ajoutant des dimensions de chaleur et de profondeur qui contrastent avec la fraîcheur des notes de tête. La rose Damascena reste néanmoins très peu utilisée en notes de fond.
Des Caractéristiques Uniques
Ce qui distingue vraiment la rose Damascena, c’est son équilibre parfait entre douceur et richesse. Elle a une capacité unique à se transformer, présentant différentes facettes olfactives à différents moments, ce qui en fait un choix prisé pour des parfums complexes et multi facettés. Son parfum peut également varier légèrement en fonction de la région de culture – les roses cultivées dans les sols riches et humides de la Bulgarie peuvent, par exemple, avoir des notes plus lourdes et plus sucrées comparées à celles cultivées dans des climats plus secs.
Distinction avec la rose Centifolia
La Rose Damascena et la Rose Centifolia, deux joyaux de l’horticulture et de la parfumerie, présentent des différences marquées tant au niveau botanique qu’olfactif.
Ces différences influencent leur utilisation dans la création de parfums et leur culture à travers le monde.
La rose Centifolia est également appelée « rose de Mai » en raison de sa période de floraison principale.
Elle se caractérise par des fleurs très pleines, avec des pétales extrêmement serrés et arrondis qui créent une forme presque parfaite de coupe.
La rose Centifolia est traditionnellement cultivée en France, notamment dans la région de Grasse, célèbre pour son industrie de la parfumerie.
Olfactivement, la rose Centifolia est connue pour son parfum doux et subtil, souvent décrit comme étant le plus proche du parfum naturel des roses fraîches. Ses notes sont délicatement florales avec des accents de miel, mais moins intenses que celles de la Damascena.
Elle est souvent utilisée dans des compositions légères et romantiques, idéale pour des parfums qui nécessitent une finesse et une élégance discrète.
Exemples de Parfums Iconiques
Nahema de Guerlain créé par Jean-Paul Guerlain en 1979 est connue comme étant l’interprétation dramatique et opulente de la rose. Le parfum s’ouvre sur des notes de bergamote, de pêche et une touche légère de bois de rose, avant de se déployer dans un cœur riche de rose bulgare et de jasmin. Le fond est un mélange chaleureux de patchouli, de vanille et de musc, enveloppant la rose dans une étreinte sucrée et boisée.
Sa Majesté la Rose de Serge Lutens créé par Christopher Sheldrake en 2000. Ce parfum met en vedette la rose de manière presque monolithique, grâce à l’essence de la rose de Damas avec une clarté lumineuse. Des notes de miel et de camomille ajoutent une douceur subtile, tandis que le musc et le bois de gaïac fournissent une base profonde, rendant ce parfum à la fois majestueux et imposant.
Portrait of a Lady des Editions de Parfums Frédéric Malle créé par Dominique Ropion en 2010 est un parfum complexe et multidimensionnel, où la rose se mêle à des notes de cassis, de framboise, de cannelle, et de clou de girofle, offrant une interprétation moderne et baroque de la celle-ci. Le fond est riche, le patchouli, le santal, l’encens, et l’ambre, créant un sillage puissant et élégant.
Isparta de Pierre Guillaume est créé en 2012. Nommé d’après la région turque célèbre pour ses roses, Isparta offre une rose sombre, presque vin rouge, avec des notes de résine, de bois rouge et un soupçon de liqueur. Le parfum combine la douceur du fruit rouge avec la profondeur du labdanum et du bois de oud, pour une interprétation riche et enveloppante de la rose.
Rose de Taïf de Perris Monte Carlo créé par Luca Maffei en 2013. Rose de Taif est une ode de la rose Damascena cultivée en Arabie Saoudite, réputée pour son parfum riche et intense. Ce parfum minimaliste mais élégant s’ouvre sur des notes fraîches de citron de Sicile et de muscade, qui introduisent le cœur floral dominé par la rose de Taif. Des touches de géranium et de bois légers soutiennent délicatement la rose, tandis que l’ambre et les muscs en fond ajoutent une chaleur subtile, offrant une longévité prolongée sur la peau. Rose de Taif se distingue par sa pureté et son élégance, idéal pour les amateurs de parfums floraux raffinés.
À la Rose de Francis Kurkdjian est créé en 2014 est un hommage vibrant à la féminité et à l’élégance, inspiré par la beauté et la fraîcheur des roses Centifolia et Damascena. Le parfum s’ouvre sur des notes lumineuses et aériennes de bergamote d’Italie et d’orange de Californie, offrant une introduction pétillante qui prépare le terrain pour le cœur floral. Au cœur, les essences de rose Centifolia et Damascena se déploient dans toute leur splendeur, accompagnées de nuances de violette et de magnolia, qui ajoutent une dimension de douceur et de sophistication. Le sillage est doux et persistant, avec des notes de base de musc et de cèdre, qui ancrent le parfum tout en lui conférant une élégance discrète.
Click Song de Une Nuit Nomade créé par Serge de Oliveira en 2022. Click Song est un hommage à Miriam Makeba, la célèbre chanteuse sud-africaine. Click Song s’ouvre sur des notes fraîches et pétillantes de bergamote, qui assez vite suivi d’une rose de Turquie accompagnée de nuances épicées de géranium et de bois de cèdre, créant une harmonie florale et boisée. Le fond est envoûtant, avec des notes d’ambre, de labdanum, de patchouli et de vanille, ajoutant rondeur et puissance.
La rose Damascena reste une des matières premières les plus prisées dans le monde de la parfumerie. Sa richesse olfactive et son histoire fascinante continuent d’inspirer les créateurs de parfums à travers le monde. Que ce soit par son essence pure ou intégrée dans des compositions parfumées, la rose de Damas est véritablement la reine des fleurs.
Alors que l’industrie de la parfumerie continue d’évoluer, la place de la rose Damascena semble assurée, grâce à son profil unique qui incite les parfumeurs à explorer de nouvelles créations. L’avenir promet de continuer à innover autour de cette fleur légendaire, en explorant peut-être de nouvelles utilisations dans d’autres domaines tels que la médecine naturelle et les produits de soin écologiques. La rose Damascena n’a pas fini de déployer ses pétales pour charmer le monde.
Article co-rédigé par Elfa et Anne-Laure Hennequin
La note de tabac en parfumerie est une véritable invitation au voyage, marquant de son empreinte l’histoire des fragrances depuis des siècles. Du tabac blond doux et miellé au tabac brun intense et cuiré, chaque variété offre une richesse de nuances qui continue d’inspirer les parfumeurs contemporains. Régulée strictement par l’IFRA pour garantir la sécurité des consommateurs, la note de tabac est désormais largement utilisée tout en respectant les normes environnementales et éthiques. Cet article explore l’histoire de la note de tabac en parfumerie, ses méthodes d’extraction, ses facettes olfactives et son utilisation dans des parfums emblématiques, offrant des découvertes sensorielles à travers cette matière première intemporelle.

Origine botanique et géographique du tabac
Le tabac, principalement des espèces Nicotiana Tabacum et Nicotiana Rustica appartient à la famille des Solanacées. Cultivé par les peuples autochtones d’Amérique depuis des millénaires, il a été introduit en Europe au XVIe siècle par les explorateurs européens, gagnant rapidement en popularité comme plante médicinale puis récréative.
Nicotiana Tabacum, originaire d’Amérique du Sud (notamment de Bolivie et du Paraguay), est la plus cultivée pour sa large feuille riche en nicotine, idéale pour les cigarettes et cigares.
Nicotiana Rustica, plus robuste et avec une teneur en nicotine plus élevée, est cultivée dans les régions froides et montagneuses d’Amérique du Nord et du Sud.
La culture du tabac est aujourd’hui mondiale, avec des régions productrices clés sur plusieurs continents. Elle nécessite un sol riche, bien drainé, et un climat tropical ou subtropical avec des précipitations suffisantes. Les principales zones de culture incluent l’Amérique Centrale et du Sud, les États-Unis (notamment la Caroline du Nord et le Kentucky), l’Inde, la Chine, et certaines régions d’Afrique comme le Zimbabwe.
La diversité géographique influence les caractéristiques des feuilles de tabac. Par exemple, le tabac cubain est réputé pour ses feuilles aromatiques, prisées pour les cigares haut de gamme, tandis que le tabac de Virginie, plus doux, est souvent utilisé dans les mélanges pour cigarettes.
Histoire et utilisation en parfumerie
Cultivé par les peuples autochtones d’Amérique depuis des millénaires. Les peuples amérindiens utilisaient le tabac lors des rituels de purification et pour implorer leurs dieux, ainsi que comme plante médicinale.
En 1492, Christophe Colomb découvre que les Indiens fument une plante appelée « petum » de diverses manières: en inspirant une fumigation, en calumets, ou encore en mastication des feuilles ou inhalation de poudre (tabac à priser).
Il a été introduit en Europe au XVIe siècle par les explorateurs européens, gagnant rapidement en popularité comme plante médicinale puis récréative. C’est Jean Nicot (origine du mot nicotine ;), ambassadeur de France au Portugal où on le cultive pour ses vertus médicinales, qui en envoie quelques feuilles à Catherine de Médicis pour soigner ses migraines en le prisant. “L’herbe à la reine, appelée aussi la “catherinaire”, provoque un engouement à la cour et s’exporte dans toute l’Europe.
D’abord utilisé pour ses vertus médicinales et récréatives avant d’être apprécié pour ses qualités olfactives, au XVIIIe siècle, le tabac infusé devient un symbole de sophistication dans les salons aristocratiques.
Au XIXe siècle, l’industrialisation et la popularité des cigares propulsent le tabac comme matière première en parfumerie, avec des artisans français intégrant des accords de tabac aux nuances boisées et cuirées.
Pendant les Années Folles, après la 1ère guerre mondiale, la femme ayant travaillé à l’usine pendant que les hommes étaient au front, s’est émancipée. Elle travaille, fume, porte des pantalons et le cheveu à la garçonne. Son parfum, comme sa coiffure la démarque des autres femmes, et elle ose les notes traditionnellement associées aux hommes comme les notes cuir, tabac, vétiver: Tabac Blond de Caron (1919), Cuir de Russie de Chanel (1928), Habanita de Molinard (1921) appelé « parfum pour cigarette » car la force de son sillage en atténuait l’odeur. Elles le glissaient sous forme de sachets dans leurs paquets de cigarette.
Puis la mode passera et reviendra dans les années 80 avec les chyprés masculins intenses, puis, à la fin du XXème et début du XXIème siècles par la parfumerie niche.Le XXe siècle voit l’essor de la parfumerie moderne grâce à des méthodes d’extraction avancées et à l’introduction de composés synthétiques, permettant d’isoler des arômes précis du tabac. Aujourd’hui, le tabac est utilisé dans une gamme variée de compositions, allant des parfums masculins classiques aux créations unisexes et féminines.

L’IFRA et la matière première tabac
L’International Fragrance Association (IFRA) régule strictement l’utilisation du tabac en parfumerie en raison de composés potentiellement cancérigènes comme les nitrosamines. Pour respecter ces réglementations tout en conservant les caractéristiques olfactives du tabac, les parfumeurs utilisent des alternatives synthétiques qui imitent ses arômes complexes sans les risques associés aux extraits naturels.
Ces molécules offrent une stabilité et une qualité constantes, essentielles pour la production industrielle. Les directives de l’IFRA définissent les concentrations maximales de certaines substances, garantissant la sécurité des consommateurs et la conformité réglementaire. Ainsi, l’innovation et le développement d’alternatives synthétiques sont essentiels pour préserver l’essence du tabac en parfumerie.
Méthodes d’extraction du tabac en parfumerie
Les méthodes d’extraction du tabac en parfumerie permettent de préserver la richesse de cette matière première. Voici les techniques les plus pertinentes :
Extraction par solvant volatile
L’extraction par solvant volatil utilise des solvants organiques comme l’hexane pour dissoudre les composés aromatiques des feuilles de tabac. Après évaporation du solvant, une concrète est obtenue, puis traitée à l’éthanol pour éliminer les cires, produisant une absolue de tabac. Cette méthode offre un extrait concentré avec des notes miellées, boisées et ambrées.
Distillation à la vapeur
La distillation à la vapeur consiste à faire passer de la vapeur d’eau à travers les feuilles de tabac, libérant les composés aromatiques. La vapeur est ensuite condensée pour séparer l’eau et l’huile essentielle. Cette technique préserve les notes fraîches et herbacées du tabac, idéales pour équilibrer les compositions parfumées.
Extraction au CO2 Supercritique
L’extraction au CO2 supercritique utilise du dioxyde de carbone sous haute pression pour extraire les arômes du tabac. Cette méthode est respectueuse de l’environnement et n’utilise pas de solvants toxiques. Elle permet d’obtenir des extraits de haute pureté avec des profils olfactifs complexes et fidèles à la matière première d’origine.
La note de tabac synthétique en parfumerie
La note de tabac synthétique offre une alternative pertinente et stable aux extraits naturels. Les molécules synthétiques, comme l‘isobutylquinoléine pour des notes cuirées et les lactones de tabac pour une douceur miellée, surmontent les limitations de qualité et d’impact environnemental des matières premières naturelles. Elles permettent aussi des accords innovants et répondent à la demande de produits véganes et éthiques, permettant aux parfumeurs de créer des fragrances sophistiquées tout en respectant les enjeux environnementaux et sociétaux.
Types de tabac utilisés en parfumerie
Le tabac blond : Issu de Nicotiana tabacum, séché à l’air chaud, cultivé en Virginie, il offre des notes douces, miellées et fruitées, apportant chaleur et confort aux parfums.
Le tabac brun : Séché à l’air ou au feu, cultivé au Kentucky et en Afrique, il présente des arômes robustes, terreux, cuirés et épicés, ajoutant profondeur et sophistication.
Le tabac vert : Séché rapidement après récolte, il conserve des notes fraîches et herbacées, ajoutant une touche vivante et naturelle, souvent associé à des accords floraux ou aromatiques.
Facettes olfactives de la note de tabac
La note de tabac, que l’on classe généralement dans la famille olfactive des boisés est riche et complexe, offrant une multitude de facettes olfactives.Voici quelques-unes des facettes les plus courantes :
Facette Cuirée : Notes de tabac brun évoquant les peaux tannées, apportant sophistication.
Facette Miellée : Douceur du tabac blond rappelant miel, fleurs séchées et fruits mûrs, idéale pour les parfums orientaux et floraux.
Facette Épicée : Nuances de clou de girofle, cannelle et muscade, apportant chaleur et complexité, souvent utilisées dans les parfums boisés et orientaux.
Facette Ambrée :notes balsamiques et résineux, riches et sensuels, se mariant bien avec vanille, patchouli et labdanum.
Facette Fumée : Notes de tabac séché au feu rappelant feux de bois et cigares, ajoutant une touche rustique et mystérieuse.
Parfums Iconiques avec Note de Tabac
Tabac Blond de Caron créé en 1919 par Ernest Daltroff (plusieurs fois reformulé), est une fragrance qui incarne l’élégance et la sophistication des années 1920. Conçu initialement pour les hommes, ce parfum est un hommage à l’indépendance et à l’audace des femmes modernes de l’époque. La fragrance s’ouvre sur des notes fraîches et pétillantes de néroli, de bergamote et de citron, offrant une envolée lumineuse et vivifiante. Le cœur floral se déploie avec l’iris poudré, l’ylang-ylang exotique et l’œillet épicé. Puis le fond est enveloppant, dominé par le tabac doux presque sucré, un cuir chaud et une vanille crémeuse, apportant une profondeur et une sensualité intemporelles. Aujourd’hui, pour accompagner son emblématique Tabac Blond, la maison Caron a lancé sa collection “Les beaux tabacs” offrant des fragrances exaltant le tabac sous différentes facettes: le lumineux “Tabac blanc”, le gourmand “Tabac Exquis”, et le chaleureux “Tabac noir”.
Chergui de Serge Lutens créé en 2001 par Christopher Sheldrake, est un parfum oriental épicé où le tabac joue un rôle central. Il s’ouvre sur des notes de tabac mêlées à du miel et des épices. Le cœur dévoile des accords de foin, de musc et de bois de santal, tandis que le fond riche en ambre et encens apporte une profondeur sensuelle.
Pure Havane de Mugler, créé en 2011 par Jacques Huclier. Pure Havane est une ode aux cigares cubains, avec des notes de tabac richement enveloppées de miel. Le parfum s’ouvre sur des accords de tabac et de vanille, suivis par un cœur où se mêlent cacao, fève tonka et patchouli. Le fond est boisée et ambrée, créant une aura envoûtante.
Volutes de Diptyque créé en 2012 par Fabrice Pellegrin. Volutes est inspiré par les voyages en bateau à vapeur des années 1930. Le parfum combine des notes de tête de tabac, miel, et fleur d’iris avec des fruits secs. Le cœur épicé comprend du foin, de l’immortelle, et du safran, tandis que le fond résineux de myrrhe, d’opoponax et de benjoin se fait profond.
Jazz Club de Maison Margiela créé en 2013 par Alienor Massenet, évoque l’ambiance feutrée et enfumée d’un club de jazz. Les notes de tête sont dominées par le citron et le poivre rose, suivies par un cœur où le tabac se mêle au rhum et à la vanille. La fragrance est portée par de la fève tonka, du styrax et du vétiver, créant une sensation chaleureuse d’élégance.
Tobacco Honey de Guerlain créé en 2014 par Delphine Jelk et Thierry Wasser, est une composition gourmande et enveloppante où le tabac et le miel jouent les rôles principaux. Les notes de tête de miel qui se fait encaustique et de tabac profond se fondent dans un cœur floral et épicé, avec des nuances de rose et de cannelle. Le fond est riche et balsamique, avec des accents de vanille et de musc.
Tabac Tabou de Parfum d’Empire créé en 2015 par Marc-Antoine Corticchiato. La fragrance est un hommage au tabac sacré et à ses arômes puissants. Le parfum débute avec des notes végétales et herbacées, évoluant vers un cœur de tabac narcotique, miellé, adouci par des accents de fleurs blanches. Le fond est boisée et résineuse, avec une touche cuirée animale.
Spicebomb Extrême de Viktor & Rolf créé en 2015 par Olivier Polge. Spicebomb Extrême est une version intense et épicée de la fragrance originale. Le parfum s’ouvre sur des notes explosives de poivre noir et de cannelle, suivies par un cœur où le tabac joue le rôle principal, enveloppé de vanille et de cumin. Le fond est puissant et balsamique, avec des notes de fève tonka et de bois.
Smoke d’Akro créé en 2018 par Olivier Cresp. Smoke d’Akro évoque l’essence enivrante de la fumée et du tabac. L’ouverture avec le bouleau apporte une note boisée et résineuse, rappelant un feu de camp. Le cœur, composé de genièvre et de benjoin, ajoute une fraîcheur aromatique et une douceur balsamique. La base riche de tabac, fève tonka et patchouli crée une profondeur chaude et terreuse, enveloppante et légèrement sucrée.
5 The Guardian Master de Spiritum créé en 2020 par Philippe Paparella-Paris, est une composition sophistiquée et nuancée. L’envolée est épicée de cardamome, de poivre et de curcuma, évoluant rapidement vers un cœur riche et complexe de tabac envoûtant, soutenu par des accords de miel, de jasmin suave et de bois de cèdre. Le fond est profond et résineux, énergétique, avec des touches de cuir, de vanille et de vétiver, offrant une expérience olfactive de puissance et d’intensité addictive.
La note de tabac, avec ses multiples facettes et sa riche histoire, continue de séduire les créateurs et les amateurs de haute parfumerie. Sa capacité à provoquer des ambiances chaleureuses et sophistiquées en fait une matière première précieuse et intemporelle. Alors que l’art de la parfumerie évolue, la note de tabac demeure une source d’inspiration inépuisable, promettant encore de nombreuses créations olfactives enivrantes à venir. Pour les passionnés de parfums, découvrir les nuances du tabac, c’est partir à la rencontre d’une histoire riche et complexe, où chaque facette raconte une histoire profonde et charismatique.
Article co-écrit par Elfa et Anne-Laure Hennequin
Le parfum, depuis toujours, transcende sa fonction première de simple agrément olfactif pour devenir un vecteur puissant d’émotions et de souvenirs. À l’intersection de la tradition séculaire de la parfumerie, des aspirations contemporaines au bien-être et à la pleine conscience, naît le parfum holistique. Cette approche révolutionnaire réinvente notre rapport aux fragrances, en les chargeant d’un nouveau rôle : celui de catalyseurs d’harmonie entre le corps, l’esprit et l’âme. Dans cet article, je vous invite à explorer l’univers du parfum holistique, qui allie l’art délicat de la parfumerie à une quête de bien-être intégral, dévoilant une nouvelle facette de la beauté olfactive où chaque note et chaque senteur portent en eux le pouvoir de transformer notre bien-être intérieur.
Nous démystifierons la philosophie qui sous-tend le parfum holistique, révélerons son essence et son utilisation à travers le monde, et distinguerons sa singularité par rapport à des pratiques voisines telles que l’aromathérapie, l’aromachologie, et l’olfactothérapie.
Au cœur de cette exploration, se trouve une promesse attrayante : celle d’une harmonie retrouvée et d’une existence embellie par des odeurs capables de toucher notre être dans sa globalité.

Qu’est-ce que le parfum holistique?
Au-delà d’une simple fragrance agréable, le parfum holistique incarne une vision où le parfum devient un pont vers un bien-être global, une harmonie profonde entre le physique, le mental et l’émotionnel. Cette philosophie de la parfumerie considère les fragrances comme des outils puissants capables d’influencer non seulement notre humeur mais aussi notre santé globale. Chaque essence, chaque note porte en elle une énergie et des propriétés spécifiques qui, une fois libérées, peuvent favoriser l’équilibre et le bien-être.
La création d’un parfum holistique est un art délicat qui requiert une compréhension profonde de l’alchimie des odeurs et de leurs effets sur l’être humain. Cela implique souvent un processus de personnalisation, où le parfumeur travaille en étroite collaboration avec l’individu pour identifier ses besoins et aspirations spécifiques. L’objectif est de concevoir une fragrance unique qui s’harmonise avec la personnalité, le mode de vie et les quêtes spirituelles de la personne, offrant ainsi une expérience olfactive profondément personnelle et enrichissante.
Histoire de la parfumerie holistique
Le parfum holistique s’inscrit dans une tradition ancestrale où les fragrances naturelles étaient utilisées à des fins thérapeutiques, rituelles et spirituelles. Dès l’Antiquité, dans des civilisations comme l’Égypte ancienne, l’Inde, et la Chine, les parfums issus de plantes, de fleurs et de résines étaient intégrés dans la vie quotidienne, non seulement pour leur agrément olfactif mais aussi pour leurs propriétés curatives et leur capacité à élever l’esprit. Ces sociétés reconnaissaient déjà l’impact profond des parfums sur le bien-être humain, un savoir qui a été progressivement intégré dans les pratiques médicales traditionnelles à travers les âges.

L’utilisation et l’appréciation mondiale du parfum holistique
Dans notre société moderne, où le stress et le rythme effréné de la vie peuvent affecter profondément notre bien-être, le parfum holistique offre une oasis de paix et d’harmonie. Sa popularité croissante témoigne d’une prise de conscience collective de l’importance du bien-être holistique et d’un retour aux remèdes naturels.
Les parfums holistiques sont intégrés dans des pratiques de soin personnel, des routines de relaxation, des séances de méditation, et même dans des environnements professionnels, où ils contribuent à créer des espaces apaisants et inspirants.
Leur capacité à nous reconnecter avec la nature, à équilibrer notre être intérieur, et à enrichir notre quotidien en fait un outil précieux dans la quête contemporaine d’une vie plus consciente et harmonieuse.
Le parfum holistique en occident
En occident, où l’intérêt pour les pratiques de bien-être naturelles et les alternatives aux produits chimiques ne cesse de croître, les parfums holistiques deviennent des incontournables de la routine de soin personnelle. Ils sont appréciés non seulement pour leur pureté et leur authenticité mais aussi pour leur capacité à améliorer le bien-être quotidien. Dans des espaces tels que les studios de yoga, les spas, et les retraites de méditation, ces parfums enrichissent l’expérience, facilitant la relaxation profonde et l’élévation spirituelle.

Le parfum holistique en Asie
En Asie, le parfum holistique se mêle aux philosophies traditionnelles comme l’Ayurveda et le taoïsme, valorisant l’harmonie du corps et de l’esprit et utilisant des plantes médicinales, dans une continuité moderne de ces pratiques anciennes. Globalement, le parfum holistique est intégré à des thérapies étendues comme la musicothérapie et la chromothérapie, enrichissant le bien-être à travers des ateliers et produits divers. Cette évolution souligne un changement vers un bien-être plus intégré et conscient, réinterprétant les traditions pour un mode de vie contemporain plus équilibré.

Comment les grandes maisons de création sont-elles impliquées ?
Givaudan
MoodScentz™+ est une technologie avancée de Givaudan conçue pour améliorer l’humeur à travers des parfums et odeurs spécifiques, soutenue par plus de 35 ans de recherche scientifique. Ce programme, développé à l’origine pour explorer l’impact des parfums sur le bien-être, utilise désormais des innovations telles que l’imagerie cérébrale InSituScanz™ pour analyser les réponses du cerveau aux odeurs. Cette technique, combinée avec d’autres méthodes comme l’IRMf, l’EEG, et la surveillance physiologique, permet de mesurer précisément les effets émotionnels et cognitifs des parfums.
Le projet intègre également des « Mood Portraits™ » où les réactions aux parfums sont évaluées à travers des images, aidant à surmonter les difficultés de verbalisation des émotions. Les données collectées ont aidé à créer une « carte des odeurs d’humeur », utilisant des techniques statistiques avancées pour formuler des parfums qui déclenchent des humeurs positives spécifiques, scientifiquement validées.
MoodScentz™+ vise trois humeurs principales : exaltation, énergie, et relaxation, offrant des applications potentielles dans divers produits allant des parfums fins aux soins personnels et aux produits bucco-dentaires. Cette approche s’aligne avec l’engagement de Givaudan à améliorer la santé et le bien-être des consommateurs, répondant ainsi à un besoin croissant de bien-être émotionnel dans un contexte de crises sanitaires, économiques, et écologiques.
IFF
Les parfums sont de plus en plus recherchés pour leur capacité à améliorer le bien-être émotionnel et physique. Ce changement de perception s’est accentué depuis la pandémie Covid, avec une prise de conscience accrue des effets thérapeutiques des plantes et de leurs parfums. Les études d’International Flavors & Fragrances (IFF) révèlent que la majorité des consommateurs désirent désormais des parfums qui augmentent leur confort émotionnel et physique.
L’utilisation des neurosciences dans la parfumerie, notamment à travers des techniques comme l’EEG et l’IRM fonctionnelle, a révolutionné la compréhension de l’impact des parfums sur le cerveau. Ces technologies permettent de visualiser comment différentes notes olfactives activent le cerveau et d’étudier les émotions sans les biais du langage. Cela conduit à la création de parfums spécifiquement formulés pour évoquer des états émotionnels ciblés tels que l’énergie, la relaxation ou la confiance.
Ce développement scientifique aide les parfumeurs à concevoir des parfums qui répondent à des besoins émotionnels précis, transformant les parfums en outils puissants pour améliorer le bien-être général. Cette nouvelle ère en parfumerie ne considère plus les parfums seulement comme des luxes ou des accessoires mais comme des vecteurs essentiels du bien-être personnel, ouvrant des voies inédites pour l’interaction entre les odeurs et les émotions humaines.
Firmenich
Les parfums ont longtemps été appréciés pour leur capacité à évoquer des souvenirs et à embellir notre quotidien. Cependant, avec les avancées en neurosciences, nous comprenons maintenant leur pouvoir d’influencer directement nos émotions et nos comportements. Cette relation est principalement médiée par le système limbique du cerveau, un centre crucial qui gère à la fois nos émotions et notre sens de l’odorat. Il est fascinant de noter que les réactions émotionnelles aux odeurs peuvent se former en seulement 3,3 secondes, le temps d’une respiration, mais ces impressions peuvent durer bien plus longtemps dans notre mémoire.
Dans ce contexte, Firmenich, un leader dans le domaine de la parfumerie, a mis en place le programme EmotiOn, soutenu par 25 années de recherche collaborative avec des partenaires scientifiques et académiques. Ce programme est à la pointe de l’innovation en parfumerie, visant à développer des parfums qui non seulement sentent bon mais qui améliorent également le bien-être émotionnel et physique de l’utilisateur. La recherche montre que 80 % des décisions quotidiennes sont influencées par nos émotions, illustrant l’importance d’intégrer les bienfaits émotionnels dans les produits de consommation courante.
EmotiOn utilise des techniques avancées pour mesurer les impacts émotionnels des parfums, adaptant ses créations aux nuances régionales qui peuvent influencer la façon dont un parfum est perçu et reçu à travers le monde. En plus de répondre aux besoins émotionnels, Firmenich a également lancé EmotiCode™, une initiative qui utilise l’intelligence artificielle pour générer des règles de conception intercatégories qui améliorent la concentration. Cette technologie a été scientifiquement validée pour aider les consommateurs à atteindre un état de flux optimal, permettant une meilleure performance mentale et une efficacité accrue dans leurs tâches quotidiennes.
Avec des consommateurs de plus en plus informés qui valorisent les fonctions holistiques des parfums, les innovations de Firmenich montrent comment la parfumerie moderne ne se limite pas à créer des fragrances; elle devient une part intégrante du bien-être général, combinant l’art de la parfumerie avec la science pour créer des expériences enrichissantes qui vont bien au-delà du simple plaisir olfactif.
Mane
WELLMOTION™ est une innovation révolutionnaire dans le domaine des produits de soins personnels, conçue pour transformer les émotions en expériences tangibles. Ce programme exploite divers produits comme les shampoings, gels douche, savons, bougies, et crèmes pour susciter des réponses émotionnelles ciblées chez les utilisateurs. Par exemple, l’application d’une crème WELLMOTION pourrait induire un état de relaxation profonde.
Cette initiative est le fruit d’une recherche avancée intégrant les sciences cognitives, les neurosciences, la psychologie et la linguistique dans une approche holistique. WELLMOTION cherche à décrypter les interactions complexes entre les sens et les émotions, et à comprendre comment les parfums peuvent influencer notre état émotionnel. En outre, le programme inclut des modules complémentaires qui enrichissent l’impact aromachologique des ingrédients, tenant compte des variations culturelles dans la perception des odeurs.
Le développement de WELLMOTION par Mane représente une avancée significative non seulement dans l’amélioration de l’expérience sensorielle des consommateurs mais aussi dans l’exploration des liens entre les parfums et les émotions. Cette démarche approfondit notre compréhension des effets profonds que les sens peuvent avoir sur les émotions, offrant une nouvelle dimension de bien-être qui va au-delà du simple plaisir olfactif.
Les marques de parfums s’y mettent
Dans les années 1990, surfant sur la vague de bien-être venue d’Asie, certaines marques avaient lancé déjà des “eaux de soins” liées à l’aromachologie, On pense à Lancôme avec Arôma (Calme – Tonic) , Clarins avec sa célèbre l’Eau Dynamisante, ou encore Shiseido et sa Relaxing Fragrance. Des initiatives qui ne gagnèrent pas encore la sphère de la parfumerie fine.
Avec La Pandémie du Covid19, certaines marques indépendantes ont remis au goût du jour les vertus thérapeutiques ancestrales du parfum.
100BON, par exemple propose une gamme de fragrances holistiques, qui selon vos humeurs et vos besoins, vous permettront de “Lâcher Prise” , de “ se sentir bien (“Breathe in”), de vous redonner du baume au coeur (“Save our Souls”) , ou de vous endormir pour de “Doux Rêves”.
AJNALOGIE prend soin de nos émotions avec des eaux de parfums 100% naturelles par Eleonore de Staël, chacune reliée à un chakra et alliant les principes de l’aromathérapie aux matières nobles de la parfumerie pour répondre à nos besoins: ancrage, désir, sérénité, confiance
On peut citer aussi L’aromachologie énergétique de la marque Petite Mila, les aroma-parfums de la marque Aimée de Mars, les parfums vibratoires de Parfum d’Éveil…
Et les marques de parfumerie sélective communiquent de plus en plus sur les bénéfices de certaines matières premières sur l’équilibre émotionnel: agrumes et énergie, lavande et relaxation, muscs et réconfort, bambou et optimisme, tubéreuse et désir…
Le parfum holistique s’inscrit dans une quête plus vaste de bien-être, où les frontières entre le physique, le mental, et l’émotionnel s’estompent. En tant que tel, il ouvre des perspectives fascinantes pour l’avenir de la parfumerie, de la santé, et du bien-être personnel. Alors que nous continuons à explorer les liens profonds entre nos sens et notre bien-être, le parfum holistique se positionne à l’avant-garde de cette exploration, promettant des découvertes et des innovations passionnantes dans les années à venir.
La Parfumerie et son Engagement pour la Planète
Dans un monde de plus en plus conscient des enjeux environnementaux, la parfumerie se positionne en acteur clé dans la quête d’une harmonie entre l’homme et la nature. À l’occasion de la journée internationale de la planète, nous explorons les contributions significatives de ce secteur, notamment à travers le prisme du sourcing éthique. Cette pratique, loin d’être une simple tendance, s’ancre dans une démarche profonde visant à réduire l’empreinte écologique de l’industrie tout en valorisant le travail des producteurs locaux.

Le sourcing éthique : une priorité pour la parfumerie
Le sourcing éthique dans la parfumerie ne se limite pas à une simple sélection d’ingrédients naturels ; il s’agit d’une approche globale et réfléchie qui englobe des considérations écologiques, économiques, et sociales. Cette démarche est devenue une priorité pour les marques soucieuses de leur impact sur la planète et désireuses de contribuer positivement aux communautés avec lesquelles elles interagissent. Voici un panel de ses différentes facettes.
Traçabilité et transparence des ingrédients
La traçabilité des ingrédients est la pierre angulaire du sourcing éthique. Elle assure que chaque composant d’un parfum peut être retracé jusqu’à sa source, garantissant ainsi qu’il a été cultivé et récolté de manière durable et éthique. Cette transparence est cruciale pour les consommateurs qui sont de plus en plus attentifs à l’origine des produits qu’ils achètent. Les marques de parfumerie mettent en œuvre des systèmes de traçabilité rigoureux, souvent appuyés par des technologies comme la blockchain, pour fournir une preuve indéniable de l’origine éthique de leurs ingrédients.
Protection des écosystèmes et biodiversité
Le sourcing éthique vise également à protéger les écosystèmes d’où proviennent les précieuses matières premières. En choisissant des ingrédients issus de cultures durables, les marques de parfumerie contribuent à la préservation de la biodiversité. Cela inclut la mise en place de pratiques agricoles qui maintiennent la santé des sols, économisent l’eau, et évitent les produits chimiques nocifs. De plus, certaines entreprises vont au-delà de leurs propres besoins en s’engageant dans des projets de reforestation et de conservation des habitats naturels, cruciaux pour la survie des espèces végétales rares utilisées en parfumerie.
Soutien aux communautés locales
Au-delà de l’aspect environnemental, le sourcing éthique a un volet social important. Il s’agit de s’assurer que les agriculteurs et les travailleurs qui cultivent et récoltent les ingrédients sont traités équitablement. Cela comprend une rémunération juste, des conditions de travail sûres, et un accès à des services essentiels comme l’éducation et les soins de santé. En soutenant le développement économique des communautés locales, les marques de parfumerie aident à créer un cercle vertueux où les pratiques durables deviennent la norme, non seulement pour la production des ingrédients de parfumerie mais aussi pour l’ensemble de l’économie locale.

Engagement en faveur d’une production durable
Le sourcing éthique ne s’arrête pas à la sélection des ingrédients ; il englobe aussi les méthodes de production. Cela signifie l’adoption de technologies propres et efficaces pour l’extraction et la distillation des essences, minimisant ainsi l’empreinte carbone de l’ensemble du processus de fabrication. Les marques investissent également dans la recherche et le développement de substituts synthétiques écologiques pour les ingrédients rares ou en voie d’extinction, assurant ainsi la pérennité des ressources naturelles.



En conclusion, le sourcing éthique en parfumerie représente une approche holistique qui tient compte de l’impact environnemental, social, et économique de chaque étape de la chaîne de production. Par ces pratiques, l’industrie de la parfumerie ne se contente pas de créer des fragrances qui captivent les sens ; elle s’engage dans une voie qui respecte et enrichit la planète et ses habitants.
Des initiatives concrètes pour une parfumerie responsable
Les initiatives concrètes mises en œuvre par l’industrie de la parfumerie pour intégrer le sourcing éthique dans leur production sont aussi diversifiées que significatives. Ces efforts reflètent l’engagement des marques à opérer non seulement dans le respect de l’environnement mais aussi en contribuant positivement à la société. Voici un examen plus approfondi de ces initiatives :
Certifications et labels écologiques
Les marques de parfumerie recherchent activement des certifications et des labels qui attestent de leurs engagements envers des pratiques durables et éthiques. Ces certifications, telles que Fairtrade (Commerce Équitable) ou Ecocert (pour les produits biologiques et écologiques), servent de garantie pour les consommateurs que les produits qu’ils achètent ont été produits selon des normes strictes respectant l’environnement et les droits des travailleurs. Ces labels ne sont pas seulement un gage de qualité mais aussi un moteur de changement vers des pratiques plus vertes dans l’ensemble de l’industrie.


Innovations en matière de fabrication et d’emballage
Les marques de parfumerie innovent constamment dans leurs procédés de fabrication pour les rendre moins polluants et réduire les déchets. L’utilisation de technologies vertes pour extraire les essences de manière plus efficace et avec une moindre empreinte carbone est un exemple. De même, l’industrie fait des avancées significatives dans l’utilisation d’emballages recyclables, biodégradables, ou réutilisables, réduisant ainsi l’impact environnemental des emballages traditionnels. Ces innovations ne sont pas seulement bénéfiques pour la planète mais répondent également à la demande croissante des consommateurs pour des produits respectueux de l’environnement.


Collaboration avec les ONG et les initiatives communautaires
Les collaborations entre les marques de parfumerie et les organisations non gouvernementales (ONG) permettent de soutenir des projets de conservation de la biodiversité et de développement durable. Par exemple, certains partenariats visent à protéger les forêts ou les espèces en danger qui sont essentielles pour certaines essences utilisées en parfumerie.
Ces collaborations peuvent également inclure le financement de programmes de développement communautaire, offrant une éducation, des formations, et des soins de santé aux communautés locales. On peut notamment saluer des initiatives telles que Parfumeurs sans Frontières.

Ce type d’engagement montre que l’impact de la parfumerie va bien au-delà de la simple production de fragrances, contribuant à un bien-être plus global.La Parfumerie et son Engagement pour la Planète
Éducation et sensibilisation
Enfin, un aspect souvent sous-estimé mais crucial des initiatives durables est l’éducation et la sensibilisation des consommateurs et des parties prenantes sur l’importance du sourcing éthique. Par le biais de campagnes de communication, d’ateliers, et de partenariats éducatifs, les marques de parfumerie s’efforcent de diffuser les valeurs de durabilité et d’éthique. L’objectif est de créer une prise de conscience qui encourage des choix de consommation responsables, soutenant ainsi les efforts de l’industrie pour un avenir plus durable.
Ces initiatives montrent l’engagement profond de l’industrie de la parfumerie envers un avenir plus vert. En adoptant des pratiques de sourcing éthique, en innovant dans la production et l’emballage, en collaborant avec des ONG, et en éduquant le public, les marques de parfumerie démontrent qu’il est possible de marier luxe et responsabilité environnementale.
Les grandes maisons de composition en parfumerie, telles que Givaudan, Firmenich, et Symrise,IFF, Mane jouent un rôle de premier plan dans l’adoption et la mise en pratique du sourcing éthique. Leur influence significative sur l’industrie, combinée à leur capacité d’innovation et leur réseau global, leur permet de mettre en œuvre des stratégies de sourcing éthique à grande échelle. Voici comment ces géants de la parfumerie intègrent le sourcing éthique dans leurs pratiques :
Givaudan
Givaudan s’engage activement dans le sourcing éthique à travers son programme de développement durable « Sourcing for Shared Value ». Ce programme vise à assurer que toutes leurs matières premières sont sourcées de manière responsable, en mettant l’accent sur la traçabilité, la biodiversité, et le bien-être des communautés locales. Givaudan collabore étroitement avec les agriculteurs pour améliorer les pratiques agricoles et garantir une rémunération équitable. L’entreprise investit également dans des projets de conservation et de restauration de l’environnement dans les régions d’où elle tire ses ressources.
Firmenich
Firmenich place la durabilité et le sourcing éthique au cœur de sa stratégie d’entreprise. Elle s’est engagée dans plusieurs initiatives visant à promouvoir la responsabilité environnementale et sociale, comme le programme « Naturals Together », qui vise à soutenir les agriculteurs et à préserver les écosystèmes naturels. Firmenich travaille à garantir la traçabilité complète de ses ingrédients naturels et à maintenir des normes élevées de durabilité et d’éthique dans toute sa chaîne d’approvisionnement. L’entreprise met l’accent sur l’innovation verte, développant des méthodes de production et d’extraction plus durables.

Symrise
Symrise adopte une approche globale du sourcing éthique à travers son initiative « Symrise Diana Food », qui se concentre sur l’approvisionnement responsable en matières premières. L’entreprise met en œuvre des pratiques de sourcing durable pour ses ingrédients, en veillant à l’impact positif sur les communautés locales et l’environnement. Symrise s’engage dans la protection de la biodiversité et soutient les programmes de développement durable qui bénéficient à la fois à l’entreprise et aux communautés locales. Par exemple, Symrise travaille directement avec les communautés de producteurs pour assurer des conditions de travail équitables et promouvoir des pratiques agricoles durables.

Pratiques communes et innovations
Ces entreprises établissent des partenariats directs avec les communautés locales pour s’assurer que les pratiques de culture sont durables et que les agriculteurs reçoivent une rémunération juste. Ces partenariats aident également à préserver les connaissances traditionnelles sur la culture des plantes et l’extraction des essences.
L’adoption de technologies avancées pour l’extraction et la distillation des essences permet de réduire l’impact environnemental et d’améliorer l’efficacité de la production.
La protection de la biodiversité est une priorité, avec des investissements dans la reforestation et dans des projets de conservation pour protéger les habitats naturels et les espèces végétales.
Ces grandes maisons s’efforcent d’obtenir des certifications reconnues qui attestent de leurs engagements en matière de durabilité et d’éthique, renforçant ainsi la confiance des consommateurs.
Les maisons de création ne se contentent pas de suivre les tendances en matière de sourcing éthique ; elles les définissent. Par leurs efforts continus, ces maisons montrent que l’industrie de la parfumerie peut jouer un rôle significatif dans la promotion de la durabilité, de l’équité sociale, et de la protection de l’environnement.
La parfumerie moderne, loin de se limiter à la création de fragrances captivantes, embrasse un rôle de gardienne de l’environnement à travers le sourcing éthique. En cette journée internationale de la planète, nous saluons les initiatives de ce secteur qui, en se réinventant, contribue activement à la préservation de notre monde pour les générations futures. Les consommateurs, de plus en plus éclairés et exigeants, jouent un rôle crucial dans cette évolution en favorisant les marques responsables. Ainsi, la parfumerie continue de nous enivrer, non seulement par ses arômes, mais aussi par son engagement envers une planète plus verte.
En Inde, où les couleurs vives du Holi se mêlent aux senteurs enivrantes des épices et des fleurs, le parfum est bien plus qu’une simple parure. Il est une offrande, un symbole de séduction et un élément essentiel de la vie quotidienne. C’est en partant pour un voyage olfactif à travers les âges que nous découvrons l’histoire riche et complexe de la parfumerie indienne, en explorant trois villes iconiques : Kannauj, Mysore et Madurai.

La parfumerie en Inde : une histoire et une culture riches
L’art de la parfumerie en Inde est profondément ancré dans l’histoire et la culture du pays. On trouve des traces de son utilisation dès les temps anciens, dans les textes sacrés comme les Vedas et les Upanishads, où les parfums et les huiles essentielles étaient utilisés dans les rituels religieux et pour purifier le corps et l’esprit.
Au fil des siècles, la parfumerie indienne s’est développée et enrichie, s’inspirant des influences persanes, arabes et chinoises. Les techniques de distillation et d’extraction des huiles essentielles se sont perfectionnées, permettant de créer une grande variété de parfums.
Le parfum occupe une place importante dans la vie quotidienne des Indiens. Il est utilisé lors des fêtes religieuses et des cérémonies, pour séduire et pour se sentir bien dans sa peau. Offrir du parfum est une marque de respect et d’affection.
Exemples de l’utilisation du parfum en Inde
Rituels religieux : Les temples indiens sont souvent embaumés de l’odeur d’encens et d’huiles parfumées. Les fidèles s’offrent des parfums pour purifier leur corps et leur esprit avant d’entrer dans le temple. On laisse en offrande aux dieux des colliers de fleurs au parfum puissant comme le jasmin ou la tubéreuse. Il est d’ailleurs recommandé de ne pas sentir ces fleurs car les humer reviendrait à voler le parfum destiné aux dieux. Ces colliers parfumés sont aussi des gages de respect dans les “puja rooms”, pièces-autels du foyer réservées à honorer et prier pour les ancêtres et les dieux hindous.
Le santal, bois sacré, fait partie intégrante des rituels religieux en Inde. On le brûle en encens dans les temples, et on place une pâte de santal sur le front des hindous en guise de protection contre le mal.
Cérémonies : Les mariages, les naissances et autres événements importants sont célébrés avec des parfums et des fleurs. Les mariés hindous s’échangent le jaimala, collier de fleurs (roses, jasmin, tagète, en fonction de la saison) , afin de sceller leur union. La tagète, symbole du soleil et de la positivité, est très populaire pour ces cérémonies.


Séduction : Le parfum est un élément important de la séduction en Inde. Les femmes et les hommes utilisent des parfums pour se rendre plus attrayants. Les femmes parfument leurs cheveux avec des huiles florales et parent leurs tresses et chignons de guirlandes de boutons de jasmin sambac qui en s’ouvrant tout au long de la journée viendront les parer d’une aura parfumée.Des guirlandes de tubéreuses, symboles du plaisir, ornent de leurs narcotiques effluves la chambre des jeunes époux pour leur nuit de noces. Soulignons que l’origine de son nom est “parfum de la nuit”.
Bien-être :De nombreuses huiles essentielles sont utilisées en Inde pour leurs propriétés relaxantes et thérapeutiques, et la médecine ayurvédique traditionnelle les emploie toujours.
Kannauj : La cité millénaire des parfums
Kannauj, berceau de la parfumerie indienne, est une ville légendaire dont les senteurs envoûtantes ont charmé les empereurs et les poètes pendant des siècles. Connue pour ses techniques de distillation ancestrales et son savoir-faire unique, Kannauj se spécialise dans l’extraction d’huiles essentielles à partir de fleurs comme le jasmin, la rose ,le kewda (dont le parfum dégage une odeur florale sucrée et fruitée, souvent comparé à la rose mais avec une touche plus exotique) ainsi que le surprenant attar mitti au parfum de terre mouillée obtenu par distillation de morceaux d’argile). Située sur les rives fertiles du Gange, est une ville légendaire dont l’histoire est intimement liée à l’art de la parfumerie. Surnommée la « capitale indienne du parfum », Kannauj envoûte depuis des siècles les voyageurs avec ses senteurs et son savoir-faire uniques.

Un héritage millénaire
L’histoire de la parfumerie à Kannauj remonte à plus de 2000 ans. La ville était déjà un centre de production important de parfums à l’époque des rois Gupta, au IVe siècle après J.-C. Les techniques de distillation ancestrales, transmises de génération en génération, ont permis à Kannauj de conserver sa place de choix dans le monde de la parfumerie.
Savoir-faire et techniques
Le secret de la renommée de Kannauj réside dans son savoir-faire unique en matière d’extraction d’huiles essentielles. La méthode traditionnelle, appelée « Dehrakh », utilise des alambics en terre cuite et un processus de distillation à la vapeur lente. Cette technique permet d’obtenir des huiles essentielles d’une grande pureté et d’une qualité exceptionnelle.

Matières premières précieuses
La région de Kannauj est particulièrement riche en fleurs et en plantes aromatiques, offrant aux parfumeurs une palette de matières premières d’une grande variété. Le jasmin, la rose, le kewda, la tubéreuse et le nard sont quelques-unes des fleurs les plus cultivées dans la région.
Parfums et spécialités
Kannauj est célèbre pour ses parfums floraux, souvent rehaussés d’épices et de bois précieux. L’attar est une spécialité de Kannauj. Il s’agit d’un parfum sans alcool de l’Inde moghole, qui résulte d’une distillation de matières aromatiques (fleurs, épices…), associées à de l’huile essentielle de santal.
Kannauj est également connue pour ses parfums naturels et ayurvédiques, fabriqués à partir d’ingrédients naturels et sans produits chimiques.
Impact économique et culturel
L’industrie du parfum est un pilier de l’économie de Kannauj. Elle emploie des milliers de personnes, des cultivateurs aux parfumeurs en passant par les artisans. La ville abrite également de nombreuses écoles de parfumerie qui perpétuent la tradition et forment les nouvelles générations.
Un patrimoine précieux
Le savoir-faire de Kannauj en matière de parfumerie est un patrimoine précieux qui doit être protégé et valorisé. La ville est aujourd’hui confrontée à de nombreux défis, tels que la concurrence des parfums synthétiques et la mondialisation. Cependant, Kannauj continue de se battre pour préserver son héritage et sa place unique dans le monde de la parfumerie.
C’est une ville fascinante qui offre un voyage olfactif unique à travers les âges. Son histoire, son savoir-faire et ses matières premières précieuses font de Kannauj un véritable trésor pour les amateurs de parfums et un symbole de la richesse de la culture indienne.
Mysore : L’héritage royal du santal
Mysore, ville majestueuse située au cœur du Karnataka en Inde, est célèbre pour son palais somptueux, ses temples fascinants et son héritage unique dans le monde du parfum. Le SANTAL ALBUM, appelé aussi santal blanc (du latin album , blanc, car le cœur de son tronc est blanc ou vert pâle) est un arbre assez fin qui vit en parasite sur les racines d’autres arbres. C’est une matière première précieuse et sensuelle, dont le parfum embaume de notes chaudes, rondes, crémeuses, lactées les parfums tant féminins que masculins. Il est intimement lié à l’histoire et à l’identité de Mysore, conférant à la ville une aura olfactive envoûtante.
Le santal : un trésor de Mysore
Le santal, connu sous le nom de « bois sacré » en Inde, est un arbre originaire des forêts tropicales du sud du pays. Mysore abrite l’une des plus grandes concentrations de santal au monde, ce qui lui vaut le surnom de « capitale du santal ».

L’histoire du santal à Mysore
L’utilisation du santal à Mysore remonte à des siècles. Les anciens rois de Mysore utilisaient le bois de santal pour ses propriétés religieuses et symboliques. Le santal était également utilisé dans les rituels royaux, les cérémonies religieuses et la médecine traditionnelle.
Le savoir-faire de Mysore en matière de santal
Mysore est renommée pour son expertise dans l’extraction et la distillation de l’huile de santal. Les artisans locaux utilisent des techniques ancestrales pour obtenir une huile de santal pure et de haute qualité, appréciée pour sa fragrance riche et boisée.
L’huile de santal : une matière première précieuse
L’huile de santal est utilisée dans une grande variété de produits, tels que les parfums, les cosmétiques, les savons et les produits d’aromathérapie, et dans la médecine ayurvédique traditionnelle Elle est également utilisée dans la fabrication d’encens et d’objets religieux.
L’impact économique et culturel du santal à Mysore
L’industrie du santal est un pilier de l’économie de Mysore. Elle emploie des milliers de personnes, des cultivateurs aux artisans en passant par les parfumeurs. Le santal est également un élément important de l’identité culturelle de Mysore et contribue à la renommée internationale de la ville.
Les défis et les perspectives d’avenir du santal à Mysore
L’industrie du santal à Mysore est confrontée à plusieurs défis. Le premier est le trafic du bois par des contrebandiers qui déciment les forêts de santal afin de les revendre au plus offrant. C’est pourquoi les forêts de santal sont désormais sous contrôle gouvernemental afin d’en gérer la filière. Cette restriction mène à d’autres problèmes tels que la contrefaçon et la concurrence des produits synthétiques. Cependant, la ville s’engage à préserver son héritage et à promouvoir le développement durable de l’industrie du santal.
Madurai, une symphonie olfactive
Madurai, ville historique du Tamil Nadu, au sud-est de l’Inde, offre une expérience olfactive unique. Temples parfumés, marchés aux épices animés et gastronomie riche en saveurs composent une symphonie olfactive qui envoûte les visiteurs.
Une histoire parfumée
L’histoire de Madurai est intimement liée aux épices. La ville était autrefois un centre important du commerce des épices, attirant des marchands du monde entier. L’air était imprégné des senteurs envoûtantes du poivre noir, du clou de girofle, du curcuma, de la muscade et du safran.
Mais surtout, le roi de Madurai, c’est son jasmin sambac.
La capitale du Jasmin Sambac (Malligai)
La variété la plus recherchée de cette fleur est cultivée dans de vastes zones autour de la ville.
Son parfum enchanteur est devenu emblématique de Madurai. La silhouette de la fleur de jasmin se révèle dans les sculptures des temples anciens, dans les œuvres picturales et dans les parures locales. Les premières références au jasmin de Madurai sont documentées par de nombreuses références à la fleur dans la littérature Sangam qui remonte à 300 av. J.-C. et 300 ap. J.-C.

Fraîchement cueillies, ces fleurs, familièrement appelées « Madurai Malli », s’écoulent sur les étals des marchés aux fleurs professionnels, les “poo” markets où les producteurs vendent leur récolte en boutons tous les matins. Les fleurs seront achetées, pour en tisser des colliers destinés aux prières et à la décoration, qui seront rapidement envoyés dans le monde entier, et bien sûr pour la parfumerie où l’extraction aux solvants volatils permettra d’en livrer concrètes et absolus divins.
Le terme « sambac » dérive phonétiquement du sanskrit « campaka » (चम्पक, prononcé tʃaɱpaka), faisant référence à des plantes au parfum enivrant.

Sa fleur possède entre 7 et 10 pétales plus charnus et cireux que ceux du grandiflorum qui libèrent un parfum teinté d’exotisme aux notes d’abord vertes et fraîches (entre peau de banane et muguet), puis solaires fruitées, miellées et animales proche de la fleur d’oranger. S’il est utilisé depuis longtemps dans les attars en Inde et au Moyen Orient. , le jasmin sambac n’a commencé à s’inviter en parfumerie fine que depuis la fin des années 1980.
Madurai : une destination olfactive incontournable
Madurai est une destination incontournable pour qui veut découvrir le jasmin sambac.
C’ est une ville qui se découvre et se savoure avec le nez. Ses temples. et particulièrement l’impressionnant Temple de Mînâkshî l’un des plus grands temples hindou du pays, ses marchés et sa gastronomie invitent à un voyage olfactif inoubliable, où les parfums et la spiritualité se rencontrent dans une harmonie parfaite.
Le parfum en Inde : une dimension économique, culturelle et religieuse
L’industrie du parfum en Inde est un secteur dynamique et en pleine expansion, avec un marché estimé à plusieurs milliards de dollars. Offrir du parfum est une marque de respect et d’affection.
L’Inde est un véritable trésor olfactif, où le parfum nous transporte dans un voyage fascinant à travers la richesse de la culture indienne.
Kannauj, Mysore, et Madurai ne sont pas seulement des noms sur une carte ; elles sont le cœur battant d’une tradition qui transcende les frontières et les âges.
L’avenir de la parfumerie en Inde semble prometteur, avec une demande croissante pour des produits authentiques et durables. Les consommateurs du monde entier cherchent de plus en plus à comprendre l’origine et la signification derrière les fragrances qu’ils portent, se tournant vers des essences qui racontent une histoire véritable. Dans cette quête de sens et d’authenticité, l’Inde offre un réservoir inépuisable d’inspiration et d’ingrédients précieux, invitant à une redécouverte des parfums traditionnels dans un contexte moderne.
Et si vous souhaitez découvrir la magie parfumée de l’Inde sur ses terres mêmes, vous pouvez vous envoler pour un des voyages olfactifs organisés par Magali Quénet, fondatrice de “Mon parfum c’est moi”. Cette passionnée de matières parfumées vous propose de partir aux sources du parfum avec l’odorat comme fil conducteur de notre quête de sens. Tout un programme…
Article co-écrit par Elfa Jouini et Anne-Laure Hennequin
À l’occasion de la Journée Internationale des droits de la Femme, le 8 mars, il est essentiel de rendre hommage aux contributions remarquables des femmes dans l’univers de la parfumerie. Historiquement, l’industrie a été perçue comme dominée par les hommes, mais au fil des décennies, des femmes talentueuses ont brisé les barrières, apportant leur sensibilité unique, leur créativité et leur vision innovante. Cet article met en lumière quelques-unes des parfumeuses les plus influentes, leurs parcours inspirants, et les créations olfactives qui ont laissé une empreinte indélébile dans le monde des parfums.
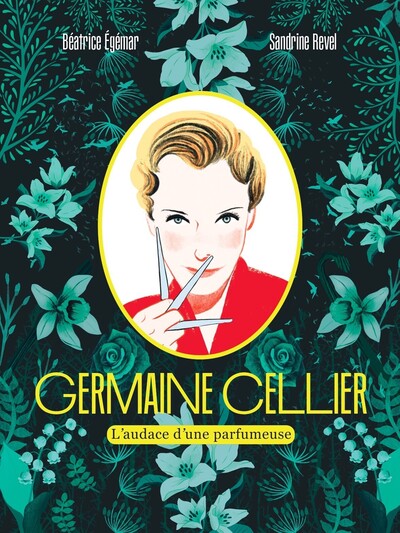
Briser les barrières traditionnelles
Les femmes se sont imposées dans le monde de la parfumerie, traditionnellement dominé par les hommes, à travers une combinaison de talent, de persévérance et d’innovation. Leur ascension dans cet art olfactif peut être attribuée à plusieurs facteurs clés qui reflètent à la fois un changement culturel et l’évolution de l’industrie elle-même.
Historiquement, la parfumerie était considérée comme une extension de la chimie, un domaine où les femmes avaient peu de présence. Cependant, avec le temps, les perceptions ont évolué, et l’éducation ainsi que l’accès accru aux formations spécialisées a ouvert des portes. Des institutions comme l’ISIPCA en France ont joué un rôle crucial en formant des générations de parfumeurs, y compris des femmes talentueuses qui ont ensuite marqué l’industrie de leur empreinte.
Sensibilité et approche
Les femmes ont apporté une sensibilité et une perspective différente à la création de parfums, exploitant souvent leur compréhension intuitive des émotions et des expériences vécues pour concevoir des fragrances qui résonnent profondément sur le plan émotionnel. Cette capacité à tisser des récits olfactifs riches et complexes a non seulement permis aux femmes de se distinguer dans le domaine mais a également enrichi la diversité des parfums disponibles sur le marché.
Innovation, créativité et mentorat
Les femmes parfumeuses ont souvent été à l’avant-garde de l’innovation, repoussant les limites de la créativité pour explorer de nouvelles facettes de la parfumerie. Que ce soit à travers l’utilisation de techniques modernes, la réinterprétation de notes traditionnelles ou le développement de nouvelles molécules, leur travail a contribué à façonner les tendances olfactives et à introduire de nouveaux standards de beauté et d’excellence dans l’industrie.
L’importance du réseautage et du mentorat ne peut être sous-estimée dans l’ascension des femmes dans la parfumerie. En établissant des liens solides avec d’autres professionnels de l’industrie et en bénéficiant du soutien de mentors, les femmes ont pu naviguer plus efficacement dans le secteur, gagnant en visibilité et en reconnaissance. De plus, de nombreuses parfumeuses établies ont pris à cœur de mentorat de la nouvelle génération, assurant ainsi un héritage de talent féminin dans la parfumerie.
Les architectes olfactives de la parfumerie moderne
Les maitres-parfumeuses
Germaine Cellier
Germaine Cellier était une pionnière dans le monde de la parfumerie, connue pour son travail révolutionnaire dans les années 1940 et 1950. Elle a créé des parfums emblématiques pour la maison Balmain, comme Vent Vert et Fracas pour R Piguet. G.Cellier est reconnue pour avoir brisé les conventions de son époque, introduisant des compositions audacieuses qui ont changé le visage de la parfumerie moderne.
Daniela Andrier
Daniela Andrier est une parfumeuse réputée travaillant principalement avec Givaudan, une des plus grandes maisons de création de parfums. Elle n’est pas parfumeuse maison pour une marque spécifique mais collabore avec plusieurs marques de luxe. D. Andrier est connue pour son approche délicate et précise de la parfumerie, avec des créations comme Infusion d’Iris pour Prada ou Untitled pour Maison Martin Margiela. Sa force réside dans sa capacité à créer des parfums qui évoquent des émotions subtiles et complexes lui a valu une reconnaissance dans l’industrie.
Calice Becker
Calice Becker est directrice de la création parfumerie chez Givaudan et a été la force créatrice derrière des parfums comme J’Adore de Dior. Sa contribution à la parfumerie va au-delà de ses créations; Aujourd’hui vice-présidente parfumeuse et directrice de l’Ecole de parfumerie de Givaudan, elle est une mentor et une source d’inspiration pour les nouvelles générations de parfumeurs, prouvant l’importance de la passion, de l’innovation et de la détermination dans la poursuite de l’excellence. En 2021, elle est la lauréate 2021 du prix « Lifetime Achievement PerfumerAward » de la Fragrance Foundation pour sa brillante carrière et son leadership visionnaire dans la promotion de l’art de la parfumerie. Calice Becker continue d’influencer l’industrie avec son travail, laissant une trace durable qui témoigne de son génie créatif.
Nathalie Lorson
Formée chez Roure, Nathalie Lorson est maître parfumeuse chez Firmenich. Elle a créé des parfums pour une multitude de marques, dont Encre Noire pour Lalique. N. Lorson est appréciée pour son aptitude à créer des fragrances complexes et enveloppantes, utilisant son talent pour explorer de nouvelles dimensions olfactives à l’image de Black Opium d’YSL. N. Lorson a recréé la collection Héritage de maison Violet avec une grande maîtrise. Elle collabore avec différentes marques en tant que parfumeuse indépendante, et a reçu plusieurs prix de reconnaissance de son talent.
Isabelle Doyen
Isabelle Doyen est une maître parfumeur dont les créations stimulent l’imagination par leur originalité et leur audace. Longtemps associée à la maison Annick Goutal, maintenant Goutal Paris, I. Doyen a été la force créative derrière plusieurs parfums emblématiques de la marque, tels que Songes et Nuit Étoilée, qui reflètent son talent pour capturer l’essence de la nature et des émotions humaines. Sa collaboration avec Camille Goutal, fille d’Annick Goutal, a conduit à une série de fragrances qui célèbrent l’héritage de la fondatrice tout en introduisant de nouvelles directions olfactives. I. Doyen est également connue pour son travail avec pour des créations indépendantes qui défient les catégorisations traditionnelles, montrant son penchant pour l’expérimentation et l’innovation.
Nathalie Feisthauer
Nathalie Feisthauer est une parfumeuse indépendante en créant Lab-Scent après avoir travaillé chez Givaudan puis Symrise. Elle a contribué à la création de parfums tels que Eau des Merveilles pour Hermès et a une réputation pour son travail innovant. Elle a reçu plusieurs prix notamment le prix du Parfumeur de l’année FIFI en 2019, le prix de la Meilleure Révélation avec le lancement de la collection Sous le Manteau en 2020,ou encore Prix FIFI avec L’Orchestre Parfum pour Electro Limonade en 2021.
Annick Menardo
Annick Menardo est une parfumeuse qui a travaillé pour Firmenich. Elle est célèbre pour ses créations audacieuses et innovantes, telles que Hypnotic Poison pour Dior et Body Kouros pour Yves Saint Laurent. A. Menardo a un talent particulier pour créer des parfums qui sont à la fois contemporains et intemporels, utilisant une gamme variée d’ingrédients pour capturer des émotions complexes.
Aliénor Massenet
Aliénor Massenet travaille en tant que parfumeuse pour Symrise, une des grandes maisons de création de parfums. Au cours de sa carrière, elle a créé des parfums pour une variété de marques, dont Memo Paris. A. Massenet est connue pour son approche détaillée et sa capacité à créer des fragrances riches et complexes, où souvenirs et émotions sont mis en avant à travers ses compositions.
Sophia Grojsman
Sophia Grojsman, travaillant principalement avec IFF (International Flavors & Fragrances), est célèbre pour son approche unique de la parfumerie. Elle a créé des parfums emblématiques tels que Eternity pour Calvin Klein et Trésor pour Lancôme. Grojsman est connue pour son utilisation généreuse des notes florales, en particulier la rose, et a été récompensée par de nombreux prix pour ses contributions à l’industrie.
Françoise Caron
Françoise Caron a travaillé sur une multitude de créations parfumées au cours de sa carrière pour différentes maisons, notamment pour Hermès avec la création de Eau d’Orange Verte. Travailleur indépendant avec une expertise reconnue, Caron est célèbre pour sa capacité à capturer la fraîcheur et la simplicité dans ses parfums, créant des œuvres qui sont à la fois délicates et puissantes.
Honorine Blanc
Honorine Blanc est une parfumeuse chez Firmenich qui a réalisé de nombreux parfums emblématiques, notamment le blockbuster Flowerbomb pour Viktor&Rolf. Sa maîtrise des compositions florales et son talent pour créer des fragrances audacieuses font d’elle une figure respectée dans le domaine. H. Blanc est connue pour son travail collaboratif avec différentes marques de luxe.
Anne Flipo
Parfumeuse chez International Flavors & Fragrances (IFF) depuis 2004, le parcours d’Anne Flipo a débuté à l’ISIPCA, où elle a développé sa passion pour les matières premières. Riche d’un talent unique, elle a créé de nombreux parfums à succès pour des marques de luxe Son expertise dans l’équilibre des ingrédients naturels et synthétiques donne naissance à des fragrances uniques et marquées. Composant pour des marques prestigieuses comme Guerlain, Yves Saint Laurent et Lancôme, Anne Flipo continue à poursuivre son œuvre et à inspirer par son travail admirable. Elle signe notament la nouvelle fragrance d’Essential Parfums, Néroli Botanica.
Une nouvelle approche pertinente
Daphné Bugey
Daphné Bugey, parfumeuse chez Firmenich, a créé des fragrances pour une variété de marques, dont Le Labo avec Rose 31 par exemple. D. Bugey est appréciée pour son savoir-faire alliant des ingrédients contemporains et traditionnels pour créer des fragrances innovantes. Elle travaille également de manière indépendante avec diverses maisons.
Sonia Constant
Sonia Constant travaille pour Givaudan et a créé des parfums pour des marques telles que Valentino, mais surtout reconnue pour son travail pour Narciso Rodriguez avec qui elle a collaboré sur une large collection autour du musc. Elle est connue pour son approche moderne et son utilisation de matières premières inattendues pour créer des parfums qui défient les conventions. S. Constant a également créé sa propre marque EllaK dans laquelle elle retranscrit toute sa sensibilité créative.
Emilie Coppermann
Emilie Coppermann, parfumeuse chez Symrise, est reconnue pour ses créations dynamiques et novatrices, notamment pour des marques comme The Different Company. Sa maîtrise des accords boisés et frais fait d’elle une figure incontournable dans l’industrie, Dance of the Dawn en est l’exemple. E. Coppermann travaille également de façon indépendante avec de nombreuses maisons, apportant son approche unique à chaque projet.
Cécile Zarokian
Cécile Zarokian est une parfumeuse indépendante qui a établi sa propre entreprise, Cécile Zarokian Parfums. Elle est connue pour des créations comme Amouage Epic Woman. C. Zarokian a gagné la reconnaissance pour son approche artisanale de la parfumerie, développant des parfums qui racontent une histoire et évoquent des émotions profondes.
Christine Nagel
Christine Nagel est actuellement la parfumeuse maison pour Hermès, ayant succédé à Jean-Claude Ellena. Avant de rejoindre Hermès, elle a travaillé sur des projets pour de nombreuses marques prestigieuses. C. Nagel est connue pour son approche narrative de la parfumerie, créant des parfums qui racontent des histoires et capturent des moments. Parmi ses créations notables chez Hermès se trouve Eau de Rhubarbe Écarlate. Sa nomination comme parfumeuse en chef chez Hermès marque une étape significative dans sa carrière, soulignant son talent et sa vision dans l’art de la parfumerie.
Mathilde Laurent
Mathilde Laurent est la parfumeuse maison pour Cartier depuis 2005, où elle est célèbre pour avoir créé une variété de parfums emblématiques, y compris La Panthère. Avant de rejoindre Cartier, M. Laurent a travaillé chez Guerlain. Son approche audacieuse et son utilisation innovante des ingrédients font d’elle une figure de proue dans l’industrie, repoussant les limites de la création olfactive.
Olivia Giacobetti
Olivia Giacobetti est reconnue pour sa capacité à capturer l’essence des choses invisibles et éphémères dans ses parfums. Elle est une parfumeuse indépendante et la fondatrice de sa propre marque, IUNX. Parmi ses créations les plus célèbres figurent En Passant pour Frédéric Malle, mettant en avant des notes subtiles de lilas. O.Giacobetti est appréciée pour son style poétique et sa capacité à créer des parfums nuancés et captivants.
Vero Kern
Vero Kern était la fondatrice de Vero Profumo, une marque niche suisse. En tant que parfumeuse indépendante, elle a créé des parfums qui sont devenus cultes dans le monde de la parfumerie niche, comme Onda, Kiki, et Rubj. Kern était connue pour son utilisation de matières premières de haute qualité et pour ses compositions audacieuses et intemporelles.
Amélie Bourgeois
Amélie Bourgeois est une parfumeuse française dont la passion et l’expertise pour la création olfactive la distinguent dans le monde de la parfumerie. Formée à l’école de parfumerie ISIPCA, l’une des plus prestigieuses au monde, Amélie a rapidement développé une signature créative unique, marquée par une exploration audacieuse des matières premières et une approche avant-gardiste de la composition. Sa vision de la parfumerie, à la fois poétique et innovante, l’a amenée à travailler sur divers projets olfactifs, des parfums de niche aux collaborations artistiques.
Anne-Sophie Behaghel
Anne-Sophie Behaghel possède également une solide formation en parfumerie, ayant affiné son talent et sa technique chez ISIPCA avant de se lancer dans une carrière distinguée dans l’industrie. Anne-Sophie est reconnue pour sa capacité à équilibrer harmonieusement complexité et subtilité dans ses créations, en témoigne son travail pour de grandes marques et projets de niche. Sa passion pour raconter des histoires à travers les parfums et son attention minutieuse aux détails font d’elle une force créative dans le domaine.
(Ensemble, Amélie Bourgeois et Anne-Sophie Behaghel ont fondé Le Studio Flair, un studio de création olfactive qui se démarque par son approche personnalisée et son engagement envers l’innovation et l’excellence.)
Sophie Labbé
Sophie Labbé, s’est initiée à l’art de la parfumerie après avoir été inspirée par Jean Kerleo, parfumeur chez Jean Patou. Elle a étudié à l’ISIPCA de Versailles avant d’intégrer IFF, où elle a exercé pendant plus de 20 ans avant de rejoindre en 2019, les équipes parisiennes de Firmenich.
Ses parfums, imprégnés de sa passion pour la nature et le romantisme, se distinguent par leur douceur et leur harmonie. Sophie Labbé est reconnue pour sa détermination à perfectionner chaque création. Ses compositions, telles que Very Irresistible de Givenchy ou Parisienne d’Yves Saint-Laurent, charment par leur capacité à révéler des ambiances et des histoires uniques.
Véronique Nyberg
Véronique Nyberg, artiste et chimiste de formation, a trouvé sa passion dans la parfumerie après ses études à l’Ecole de Parfumerie d’IFF. Son parcours l’a conduite à travers différentes villes, affinant sa créativité et sa maîtrise des contrastes. En 2014, elle a rejoint MANE à Paris en tant que vice-présidente de la création de parfumerie fine. Sa signature artistique réside dans l’harmonie subtile des opposés. Pour Véronique, l’innovation est le fruit d’une introspection profonde, nourrie par les expériences et l’imagination, donnant naissance à des créations singulières et envoûtantes.
Et tant d’autres encore… Aujourd’hui , la parfumerie a la chance de voir continuer d’émerger de nombreuses parfumeuses, lui faisant bénéficier toujours plus de cette sensibilité artistique féminine.
Des contributions extraordinaires à la parfumerie
Les contributions de ces femmes extraordinaires à la parfumerie sont inestimables. Elles ont non seulement pavé la voie à d’autres femmes créatives dans ce domaine traditionnellement masculin mais ont également enrichi notre monde avec des fragrances qui éveillent les sens et suscitent des émotions profondes. Leur héritage inspire une nouvelle génération de parfumeuses à explorer sans limites l’art de la parfumerie, promettant un avenir où les frontières de la créativité et de l’innovation continuent d’être repoussées. En célébrant la Journée Internationale de la Femme, nous reconnaissons non seulement leurs réalisations passées mais aussi l’impact futur des femmes dans l’industrie de la parfumerie.
L’imposition des femmes dans la parfumerie reflète un changement plus large dans la société vers une plus grande égalité des sexes et la reconnaissance du talent indépendamment du genre. Leur succès dans cet art olfactif souligne l’importance de la diversité des perspectives et des expériences dans la création de parfums qui inspirent liés à la détermination qui peut mener à l’excellence, indépendamment du genre.
À l’occasion de la fête du mimosa, explorons ensemble le mimosa en parfumerie, depuis son environnement géographique et botanique jusqu’à son utilisation dans la création de fragrances. Découvrons son odeur naturelle, les modes d’extraction utilisés pour capturer son essence, et analysons les nuances olfactives qui en font une note prisée des parfumeurs. Enfin, nous mettrons en lumière une sélection de parfums qui incarnent la richesse du mimosa.
L’environnement géographique et botanique du mimosa
Le mimosa, symbole de délicatesse et de résilience, trouve ses origines dans les terres lointaines d’Australie. Cet arbuste, qui fait désormais partie intégrante du paysage méditerranéen, et en particulier sur la Côte d’Azur, est reconnu pour sa floraison hivernale, offrant des touches de couleur et de chaleur dans le paysage souvent sombre de la fin de l’hiver.
Le mimosa, appartenant à la famille des Fabaceae et caractérisé par ses gracieuses feuilles et ses bouquets de fleurs jaunes sphériques, fleurit de janvier à mars, apportant couleur et parfum aux paysages hivernaux.. Au-delà de son esthétisme, le mimosa joue un rôle écologique crucial en fixant les sols et en servant d’habitat pour la faune, tout en ayant une importance culturelle, notamment dans la région de la Côte d’Azur où il est célébré pour sa résilience et sa beauté qui égayent les paysages en fin d’hiver.
L’odeur du mimosa et son mode d’extraction
Cette senteur, à la fois délicate et complexe, fait du mimosa une essence prisée en parfumerie pour sa capacité à apporter luminosité et élégance aux compositions.
L’odeur du mimosa
Sa senteur naturelle se distingue par une douceur enveloppante, où se mêlent des notes florales légèrement poudrées et amandées à un fond miellé et un soupçon de verdure fraîche. Cette alchimie olfactive évoque la douceur printanière, de soleil doux. L’odeur du mimosa est à la fois délicate et puissante, lumineuse et apaisante.
En parfumerie, le mimosa apporte une touche de lumière et de chaleur aux compositions, se mariant harmonieusement avec des notes boisées, ambrées, ou encore avec des accords floraux et verts.
Les nuances de l’odeur du mimosa sont multiples : au premier abord, elle peut paraître simplement sucrée et florale, mais une attention plus soutenue révèle sa richesse et sa complexité. Les facettes vertes et fraîches rappellent les premiers jours du printemps, tandis que les touches poudrées et miellées offrent une profondeur et une chaleur enveloppante, créant un équilibre parfait entre vivacité et douceur.

Les modes d’extraction
L’extraction de l’essence de mimosa pour son utilisation en parfumerie est un processus délicat qui vise à capturer toute la complexité de sa fragrance. Les fleurs de mimosa sont particulièrement fragiles, ce qui nécessite des méthodes d’extraction soigneuses pour préserver leur essence authentique.
- L’extraction aux solvants volatils permet d’obtenir un absolu de mimosa., Les fleurs sont plongées dans un solvant, de l’hexane le plus souvent, qui capture les composés volatils. Une fois saturé de parfum, on fait évaporer le solvant afin de recueillir une concrète, sorte de cire parfumée, qui sera lavée à l’alcool afin d’en séparer les matières grasses et ainsi obtenir l’absolu. Cet absolu, très concentré, offre aux parfumeurs une matière première de haute qualité pour leurs créations.
- L’extraction au CO2 supercritique, appliquée au mimosa, permet d’obtenir une essence pure et de haute qualité de cette fleur sans utiliser de solvants chimiques. En exploitant le CO2 à l’état supercritique, qui combine les propriétés d’un gaz et d’un liquide, cette méthode extrait, à basse température, les composés aromatiques délicats du mimosa tout en préservant leur fraîcheur et leur intégrité. Ce processus respectueux de l’environnement , offre un extrait complexe fidèle et à son parfum naturel.
Quelques parfums autour du mimosa
Plusieurs créations olfactives mettent à l’honneur le mimosa, chacune interprétant à sa manière cette fleur solaire. Parmi les parfums emblématiques, on peut citer :
Farnesiana de Caron, un parfum floral lancé en 1947 par Michel Morsetti, interprète le mimosa avec une composition riche et nuancée. En tête, des accords de mimosa se mêlent à des effluves de foin, de cassis et de bergamote, introduisant une ouverture complexe et accueillante. Le cœur se déploie autour de la violette, du jasmin et du muguet, créant un bouquet floral profond et envoûtant grace au beurre d’iris. En fond, la vanille, le bois de santal, l’opoponax et le musc apportent une base chaude et résineuse, finissant sur une note douce et miellée.
Mimosa Pour Moi de L’Artisan Parfumeur par Anne Flipo en 1992
Ce parfum est une célébration pure et simple du mimosa, offrant une fragrance fraîche et légèrement sucrée. La composition s’ouvre sur des notes vertes qui évoluent vers un cœur floral et poudré, capturant l’essence délicate et ensoleillée du mimosa. La base révèle une touche de vanille, ajoutant une dimension douce et confortable à la fragrance.
Champs-Élysées de Guerlain Olivier Cresp 1996
Inspiré par l’avenue parisienne éponyme, ce parfum floral et fruité mêle le mimosa à la rose, à l’amande et à des notes fruitées de melon et de pêche. La présence du mimosa apporte une douceur unique à la composition, faisant de Champs-Élysées une fragrance joyeuse et sophistiquée, le fond reste à peine gourmand pour une fragrance lumineuse.
Summer by Kenzo, créé par Alberto Morillas en 2005, est un parfum qui évoque l’été avec ses notes de tête d’agrumes et de bergamote. Le cœur floral mêle mimosa et lait d’amande à des fleurs délicates comme le muguet et le jasmin, tandis que les notes de fond combinent musc, citron, ambre et bois pour une finition chaude et ensoleillée. Une invitation aux plaisirs estivaux, une fragrance à la fois fraîche et profonde, parfaite pour évoquer la saison la plus lumineuse de l’année.
Le Mimosa de Goutal par Isabelle Doyen et Camille Goutal créé en 2011
Le Mimosa est une ode à cette fleur, avec une interprétation fraîche et lumineuse. Les notes de mimosa sont accompagnées par des accords de pêche et d’iris, créant une fragrance douce, poudrée et légèrement fruitée, qui évoque le premier souffle du printemps.
Mimosa & Cardamom de Jo Malone créé en 2015 par Marie Salamagne
Un parfum chaleureux et épicé, où le mimosa rencontre la richesse de la cardamome. Cette combinaison crée une fragrance à la fois réconfortante et revigorante, avec le mimosa apportant une douceur florale et la cardamome ajoutant une dimension épicée et aromatique. Le fond porté par de la fève de Tonka enrobe le tout pour renforcer la douceur.
Infusion de Mimosa de Prada lancé en 2016 et créé par Alberto Morillas, est une ode olfactive au mimosa, mêlant délicatesse et éclat. Intégrée à la collection Les Infusions, elle est empreinte de la sophistication de Prada. Des notes florales s’entrelacent autour du mimosa, évoquant une brise embaumée de fleurs. La composition, subtile et équilibrée, se complète par des notes de fond chaleureuses qui ajoutent profondeur et réconfort. Ce parfum, à la fois moderne et intemporel, est idéal pour ceux qui désirent une essence florale pure au quotidien.
Mimosa Indigo de l’Atelier Cologne créé en 2016
Un parfum qui fait partie de la collection des Cologne Absolues, combinant le mimosa à des notes riches et profondes comme le cuir et le bois de santal. Le résultat est une fragrance complexe et sophistiquée, où la douceur du mimosa se mêle à des accords plus sombres et enveloppants, offrant une interprétation unique de cette fleur alliée à la bergamote et au lila sur un fond racé.
Mimosa Tanneron de Perris Monte Carlo par Jean-Claude Ellena en 2020
Nommé d’après la région de Tanneron, célèbre pour ses forêts de mimosas en France, ce parfum capture l’essence de la fleur avec une fidélité exceptionnelle. La fragrance s’ouvre sur des notes fraîches et vertes, conduisant à un cœur riche de mimosa, avant de se poser sur une base boisée et légèrement sucrée, reflétant la complexité et la beauté de la fleur.
Mimosa de Le Couvent créé en 2021 par Jean-Claude Ellena
Ce parfum est probablement une célébration du mimosa dans sa forme la plus pure et naturelle. On peut s’attendre à une fragrance délicate, mettant en avant la douceur et la luminosité caractéristiques du mimosa, éventuellement accompagnée de subtiles notes vertes ou boisées pour compléter son profil olfactif.
Créé en 2021 par Amélie Bourgeois, Mimosa Supercritique de Les Eaux Primordiales est une ode à la mimosa, utilisant l’extraction au CO2 pour capturer l’essence pure de la fleur. La fragrance s’initie par des notes de tête vivifiantes d’aldéhydes, cyclamen, bergamote et néroli, évoluant vers un cœur floral de jasmin, tubéreuse et fleur d’oranger. En fond, le mimosa se mêle aux muscs blancs et à l’ambroxan, créant un parfum qui marie tradition et innovation, pour une signature olfactive riche et moderne.
Chacun de ces parfums offre une interprétation distincte du mimosa, démontrant la versatilité et la richesse de cette note en parfumerie.
Le mimosa est une source d’inspiration inépuisable en parfumerie, offrant une palette de fragrance qui va de la douceur poudrée à la chaleur miellée. Sa culture, son extraction, et sa place de choix dans les compositions olfactives en font un véritable trésor pour les amateurs de parfums. La diversité des parfums autour du mimosa témoigne de sa richesse et de son universalité, invitant à un voyage sensoriel à chaque effluve
L’univers du parfum en Chine représente un fascinant voyage à travers le temps et les sens. De l’ancienne Chine, où les parfums étaient enracinés dans les traditions culturelles et spirituelles, à l’ère moderne où l’innovation et les tendances mondiales redéfinissent les préférences olfactives, la parfumerie chinoise est un témoignage vivant de l’évolution et de la richesse des senteurs.
Cet article plonge dans l’histoire, les pratiques et les symboles de la parfumerie en Chine, révélant comment ce pays immense et diversifié a façonné et continue de modeler le monde des parfums.
La Parfumerie dans la Chine ancienne et moderne
L’histoire de la parfumerie en Chine est un témoignage fascinant de l’évolution culturelle et technique. Elle illustre comment un art ancien peut s’adapter et prospérer dans un contexte moderne, tout en restant fidèle à ses racines.
La parfumerie chinoise, avec ses origines anciennes enracinées dans les rituels et la médecine traditionnelle, a traversé les âges, évoluant d’une pratique sacrée à une industrie dynamique. Autrefois, les parfums naturels comme l’encens et les huiles essentielles servaient autant les cérémonies impériales que le bien-être quotidien, tandis que la « salive de dragon » ou l’ambre gris incarnait la rareté et le mystique. Ces traditions, enrichies par les influences étrangères via la Route de la soie, ont façonné une identité olfactive unique, mélangeant les dons de la nature et les apports des échanges culturels.
Avec la mondialisation, la Chine moderne a embrassé les tendances internationales, intégrant des éléments de parfumerie étrangers tout en valorisant les marques de luxe. Cette ouverture s’est accompagnée d’une quête pour préserver l’authenticité des techniques et des ingrédients locaux, témoignant d’une volonté de fusionner l’ancestral et le moderne. La parfumerie chinoise contemporaine, ancrée dans son riche passé mais tournée vers l’innovation, continue de prospérer, honorant son héritage tout en se réinventant constamment.

Le rapport des Chinois aux parfums et aux odeurs
La relation qu’entretient la Chine avec les parfums et les odeurs est profondément ancrée dans son histoire, sa philosophie et sa médecine traditionnelle. Cette relation va bien au-delà de la simple appréciation esthétique pour inclure des dimensions culturelles, spirituelles et thérapeutiques.
Dans la société chinoise, les parfums ne sont pas seulement perçus comme un moyen d’embellissement personnel mais aussi comme une voie vers l’équilibre et l’harmonie intérieure et extérieure.
Historiquement, les Chinois ont utilisé les parfums dans divers rituels religieux et cérémonies pour purifier l’air, éloigner les mauvais esprits ou faciliter la méditation. L’encens, en particulier, joue un rôle central dans les pratiques bouddhistes et taoïstes, symbolisant la transformation et la montée des prières vers le ciel. Ces usages reflètent une approche holistique de la vie, où les senteurs sont intégrées à la quête de bien-être spirituel et physique.
Dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise, les odeurs jouent un rôle crucial dans le diagnostic et le traitement des déséquilibres corporels. Certains parfums sont utilisés pour leurs propriétés curatives, capables d’influencer le flux d’énergie (Qi) dans le corps, d’harmoniser le Yin et le Yang, ou de traiter des pathologies spécifiques. Cette utilisation médicinale des parfums souligne la croyance en une connexion intrinsèque entre les odeurs et la santé.
Les matières premières les plus appréciées en parfumerie
La parfumerie chinoise, riche de sa longue histoire et de ses traditions, repose sur une palette de matières premières qui reflètent à la fois l’abondance naturelle du pays et sa philosophie harmonieuse. Ces ingrédients, choisis avec soin, sont au cœur de la création de parfums en Chine, alliant héritage ancestral et aspirations contemporaines.
En Chine médiévale, les dynasties des Tang (616-907) et des Song (960-1279) aiment baigner dans une atmosphère parfumée. Outre les parfums à brûler qui purifient, on prend des bains d’eaux parfumées (citronnelle, fleurs de pêche), on parfume ses vêtements à l’aide de fumigations et de sachets parfumés glissés dans les plis des des manches (camphre de Bornéo). On absorbe des préparations parfumées que la peau exhale pour être ensuite transmises par attouchements.
Les constructions sont aussi parfumées grâce à l’intégration de bois parfumé (santal) et en mélangeant au mortier des matières odorantes (camphre, muscs).
La pharmacopée intègre de nombreuses plantes aromatiques aux vertus curatives: le jasmin est fortifiant, la rose digestive, et le gingembre, lui, guérit tout !
L’Empire Chinois usait aussi de cannelle, camphre, basilic, citronnelle, styrax, civette et musc.
Si certaines de ces matières ont parcouru le temps jusqu’à nous, aujourd’hui les matières phares des parfums de cette région sont les suivants:
- Le bois de Santal, avec son parfum riche, boisé et doux, est un pilier de la parfumerie chinoise. Utilisé tant dans les pratiques spirituelles que comme composant de parfums, il est réputé pour ses propriétés apaisantes et méditatives.
- le musc historiquement valorisé pour sa profondeur et son intensité, joue un rôle significatif dans la création de parfums complexes et durables. Bien que l’usage de musc naturel soit aujourd’hui restreint pour des raisons éthiques, les alternatives synthétiques cherchent à recréer ses nuances chaudes et enveloppantes.
- Le jasmin sambac, avec son parfum floral aux facettes fruitées, exquises et suaves, est une essence prisée en Chine, symbolisant souvent la beauté et la sensualité. Il est fréquemment utilisé dans les compositions florales, apportant une touche de douceur et d’élégance. Il parfume aussi le thé et le riz.
- Les notes de thé vert (souvent reproduites synthétiquement) apportent une fraîcheur végétale et une légère astringence aux parfums. Cette note caractéristique est appréciée pour sa capacité à évoquer la tranquillité et la pureté.
- L’osmanthus, avec son parfum délicat et légèrement fruité, est un symbole de finesse et de sophistication. Ses notes à la fois florales, abricotées et cuirées lui confèrent une place de choix dans de nombreuses compositions olfactives.

Les marques de parfumerie chinoise
L’industrie de la parfumerie en Chine a connu une croissance exponentielle ces dernières années, avec l’émergence de marques locales qui rivalisent désormais sur la scène internationale. Ces marques puisent dans l’héritage culturel chinois, tout en adoptant des approches modernes pour créer des parfums uniques qui captivent à la fois les consommateurs locaux et mondiaux. Voici quelques-unes des marques de parfumerie chinoises les plus influentes et innovantes :
Partenariat entre Hermès et la créatrice chinoise Jiang Qiong Er, Shang Xia est une marque qui incarne l’harmonie entre la tradition et la modernité. Bien que principalement connue pour ses produits de luxe et son artisanat, Shang Xia a également développé une ligne de parfums qui reflète l’esthétique et la philosophie de la marque. Leurs parfums sont une célébration de la culture et de l’artisanat chinois, offrant des compositions olfactives qui évoquent les paysages, les histoires et les émotions de la Chine.
Scent Library est une marque avant-gardiste qui se distingue par sa démarche innovante en matière de création de parfums. Avec des boutiques au design unique qui ressemblent à des bibliothèques contemporaines, elle propose une vaste collection de parfums inspirés par des éléments inattendus, tels que des souvenirs d’enfance, des concepts abstraits ou des phénomènes naturels. Scent Library réussit à fusionner l’art de la parfumerie avec la culture pop, rendant le parfum accessible et ludique.
Herborist, une marque qui tire son essence de la médecine traditionnelle chinoise, illustre parfaitement la manière dont les savoirs ancestraux peuvent être transposés dans le domaine de la beauté et de la parfumerie contemporaines. Ses produits, y compris ses parfums, sont formulés à partir d’ingrédients naturels issus de la pharmacopée chinoise, visant à créer une harmonie entre le corps et l’esprit. Herborist en collaboration avec Centdegrés signe Mon Instant, un parfum centré sur le bien-être.
Cha Ling est une marque qui encapsule l’esprit de la culture du thé du Yunnan et son lien avec la nature. Propriété du groupe LVMH, Cha Ling se spécialise dans les produits de beauté mais a récemment étendu sa gamme pour inclure des parfums qui exploitent les arômes délicats et revigorants du thé Pu’er. Les parfums de Cha Ling sont une ode à la simplicité, à la pureté et à l’élégance, mettant en avant les nuances subtiles du thé et les richesses botaniques du Yunnan.
Catégories Olfactives en Vogue en Chine
La parfumerie en Chine, à l’instar de sa culture, est un mélange de tradition et de modernité, reflétant les préférences et les valeurs esthétiques du pays. Les catégories olfactives populaires en Chine sont le reflet d’une appréciation pour les parfums qui harmonisent subtilement les sens, évoquant à la fois la richesse de l’héritage chinois et les tendances contemporaines. Voici un aperçu des catégories olfactives les plus convoitées en Chine :
Florales
Les parfums floraux occupent une place de choix dans les préférences olfactives en Chine, appréciés pour leur capacité à évoquer la beauté naturelle et la délicatesse. Les notes de jasmin, de rose, de fleur de cerisier, et d’osmanthus sont particulièrement prisées, offrant une gamme de fragrances qui vont de la douceur subtile à la richesse enivrante. Ces parfums sont souvent perçus comme une expression de féminité et d’élégance, établissant un lien profond avec la flore luxuriante et diverse du pays.
Boisées
Les parfums boisés, avec leurs notes de santal, de cèdre, et de vétiver, sont également très appréciés pour leur chaleur et leur profondeur. Ces fragrances évoquent la force, la stabilité et la sérénité, rappelant les forêts anciennes et les jardins traditionnels chinois. Les parfums boisés sont souvent recherchés pour leur caractère unisexe, offrant une alternative sophistiquée et terre-à-terre aux notes florales plus légères.
Fraîches
Les catégories olfactives fraîches, incluant les aquatiques, les hespéridées et les notes vertes, sont particulièrement appréciées pour leur capacité à revitaliser et à évoquer la pureté. Les parfums frais sont souvent associés à la jeunesse et à la vitalité, offrant une sensation de propreté et de renouveau. Les notes de thé vert, de menthe, de bambou, et de citron sont fréquemment utilisées, reflétant une appréciation pour la simplicité et l’harmonie avec la nature.
Épicées
Bien que peut-être moins dominantes que les autres catégories, les fragrances épicées trouvent leur place dans le paysage olfactif chinois, offrant chaleur et exotisme. Les notes de gingembre, de cannelle, de poivre et de cardamome apportent une richesse et une complexité qui peuvent être à la fois stimulantes et réconfortantes. Ces parfums évoquent les marchés d’épices, les cuisines traditionnelles et les cérémonies anciennes, jouant sur le contraste entre le familier et l’exotique.
Gourmandes
Les parfums gourmands, bien que relativement nouveaux sur le marché chinois, gagnent en popularité, surtout parmi les jeunes consommateurs. Ces fragrances, avec leurs notes sucrées et presque comestibles, comme la vanille, le caramel et les fruits, apportent une touche de joie et de ludisme. Elles évoquent les délices de la cuisine chinoise et des festivals traditionnels, créant une connexion émotionnelle forte et nostalgique.
La parfumerie en Chine est un miroir de sa culture : riche, diversifiée et en constante évolution. Alors que le marché chinois continue de s’ouvrir aux influences mondiales, il reste fidèle à ses racines, offrant un terrain fertile pour l’innovation et la créativité. L’avenir de la parfumerie en Chine s’annonce aussi parfumé et vibrant que son passé, promettant de nouvelles découvertes olfactives et des tendances passionnantes à venir.
Envie de prolonger ce voyage olfactif autour du monde ?
Le nouveau Pocket Quiz par Master Parfums, « Le Tour du Monde en Parfums« , c’est 120 questions et réponses qui vous invitent à un voyage captivant à travers les traditions parfumées et les techniques de pointe du monde entier.
Voici le monde captivant des parfums hespéridés, où la fraîcheur des agrumes se mêle à l’art subtil de la parfumerie. Cet article vous invite à un voyage olfactif à travers l’histoire, les ingrédients, et les techniques d’extraction qui définissent la famille des hespéridés. Découvrez les agrumes emblématiques comme la mandarine, le citron, et la bergamote, ainsi que des notes moins conventionnelles telles que le cédrat ou le yuzu. Nous explorerons également des parfums iconiques qui ont marqué cette catégorie, révélant comment les hespéridés continuent de captiver nos sens et d’enrichir l’univers de la parfumerie.

L’Histoire des Hespéridés : Un Voyage dans le Temps
Historiquement, les hespéridés étaient appréciés pour leurs propriétés rafraîchissantes et antiseptiques. Aujourd’hui, ils sont utilisés pour créer des parfums dynamiques et pétillants, souvent associés à des notes florales ou épicées pour une signature plus complexe.
Le jardin des Hespérides
La fascinante histoire des parfums hespéridés débute dans l’antiquité mythologique, s’étend à travers les siècles et continue d’influencer la parfumerie contemporaine.
La facette/famille olfactive des hespéridés tire son nom des Hespérides, nymphes de la mythologie grecque. Selon le mythe, ces nymphes gardaient le jardin précieux où poussaient les “pommes d’or”, offrant immortalité et fécondité aux dieux de l’Olympe et dont la description évoquait les oranges. Cette interprétation serait cependant un anachronisme car à cette époque, les agrumes n’existaient pas dans cette région! Il s’agirait peut-être du coing, traduction littérale du mot pomme d’or en grec. Néanmoins, cette idée des agrumes dans le jardins des Hespérides s’est ancrée d’autant plus que souvent décrit comme un paradis terrestre, ce jardin évoquait un monde de fraîcheur et de pureté, idées toujours associées aux agrumes dans la parfumerie.
L’essor des agrumes en Europe
Les agrumes sont originaires d’Asie du Sud-Est. Leur introduction en Europe, notamment grâce aux conquêtes et aux échanges commerciaux, a marqué un tournant. Les citrons, les oranges, et d’autres agrumes devinrent des ingrédients prisés pour leurs vertus médicinales, leurs propriétés rafraîchissantes et leur parfum vivifiant.
Au 17ème siècle, la fascination pour les agrumes s’intensifie en Europe. Les parfumeurs italiens, en particulier, commencèrent à expérimenter des associations d’huiles essentielles d’agrumes avec les herbes aromatiques des jardins des simples de l’époque. Ces expériences donnèrent naissance aux premières eaux de Cologne et à des parfums légers qui contrastaient avec les senteurs plus lourdes et opulentes de l’époque. Cette période marque le début de l’utilisation systématique des hespéridés en parfumerie.
L’âge d’or des hespéridés
L’âge d’or des hespéridés s’est étendu du 18ème au 19ème siècle. Durant cette période, les parfums hespéridés étaient au confluent de l’hygiène et du plaisir et, utilisés par la noblesse et la haute société, ils étaient synonymes de raffinement et d’élégance.
Matières Premières Phares : Les Agrumes au Cœur des Créations
Les hespéridés, avec leur essence captivante et rafraîchissante, se distinguent dans l’univers de la parfumerie grâce à des matières premières spécifiques : les agrumes. Ces fruits, véritables joyaux de la nature, sont au cœur des créations les plus emblématiques de cette facette/famille olfactive.
Variété des agrumes utilisés
Le citron: Symbole de fraîcheur, le citron offre une note pétillante mordante et légèrement acidulée, très prisée pour son éclat et sa vivacité.
L’orange : Avec ses nuances douces et fruitées, l’orange apporte une chaleur et une rondeur appréciées, particulièrement dans les compositions hespéridées douces.
La bergamote: Connu pour le parfum qu’il apporte au thé earl grey, elle est prisée pour sa subtile amertume et sa fraîcheur verte et florale. Cet agrume est un incontournable, apportant une touche élégante et raffinée.
La mandarine: Plus douce et légèrement sucrée, la mandarine enrichit les parfums hespéridés d’une facette joyeuse et ensoleillée.
Le pamplemousse : Son caractère à la fois amer et frais en fait une note de tête idéale pour des parfums dynamiques et modernes.
En plus des agrumes classiques comme le citron, l’orange et la bergamote, les fragrances hespéridées s’enrichissent grâce à l’utilisation de fruits moins conventionnels mais tout aussi captivants, tels que le cédrat, le yuzu et la bigarade. Chacun de ces agrumes apporte une dimension unique aux compositions parfumées.
Le cédrat : fruit ancien, il offre un parfum plus robuste et moins acide que le citron classique. Il possède des notes vertes et légèrement florales, qui apportent une complexité intéressante aux fragrances.
Le yuzu : Exotisme et fraîcheur. Originaire d’Asie de l’Est, le yuzu est célèbre pour son parfum unique, combinant des notes de pamplemousse, de mandarine et de citron vert. Il apporte une touche exotique et une fraîcheur piquante aux parfums.
La bigarade : ou orange amère sophistiquée, se distingue par ses notes fraîches et légèrement amères. Elle est souvent utilisée pour ajouter une dimension raffinée et un contraste intéressant dans les parfums hespéridés.
La limette: vive et verdoyante, ce petit agrume typique du Mexique possède une note qui rappelle un peu le coca-cola ou la key lime pie, dessert iconique de Floride.
Le combawa: aussi appelé kaffir lime, dont les feuilles sont prisées comme épices en Thaïlande et en Inde , il offre des facettes citronnelle, géranium et aldéhydées, propres et toniques.
Le calamansi ou calamondin:petit agrume des Philippines, vif et fusant, encore très très peu utilisé en parfumerie.
Le citron caviar: Petit agrume d’Océanie dont la pulpe se compose de petites billes croquantes rappelant le caviar. On l’appelle aussi « fingerlime » citron doigt), du fait de sa taille et sa forme allongée. (de 4 à 10 cm). Sa peau très fine qui peut être noire, verte, jaune ou rouge ne permet pas d’en extraire d’essence. C’est sa texture croquante et acidulée qui est reproduite en parfum.
Les intrus:
Un peu à part au royaume des hespéridés, on peut aussi parler de matières qui, bien qu’elles ne soient pas des agrumes, sont catégorisées dans cette facette. Elles sont souvent à mi-chemin de la facette hespéridée et de la facette verte.
La citronnelle: plante d’Asie bien connue pour ses qualités répulsives aux moustiques, on distille ses longues feuilles qui offrent une huile verte et citronnée.
Le lemongrass: souvent confondu avec la citronnelle, le lemongrass exhale des notes herbacées, citronnées et plus fruitées.
Le petit-grain: c’est l’huile essentielle obtenue par distillation des feuilles et rameaux du bigaradier (oranger amer). On les appelle aussi brouts. Il sont taillés au moment oú les fleurs donnent place Vert, hespéridés et croquant, il apporte de la joie aux notes de tête.
La verveine: connue pour ses vertus digestives, la verveine apporte sa fraîcheur citronnée et verte aux eaux de cologne.
Le gingembre: ici on flirte davantage avec la facette épicée. Fusant et vif, parfois légèrement savonneux, le gingembre apporte sa touche citronnée exotique et piquante.
Cultures et terroirs
Ces agrumes sont cultivés dans des terroirs spécifiques, souvent caractérisés par un climat méditerranéen. La qualité des fruits dépend largement de l’ensoleillement, de la nature du sol et du savoir-faire des cultivateurs. Les régions d’Italie, d’Espagne et certaines zones de l’Afrique du Nord sont réputées pour produire des agrumes de haute qualité pour la parfumerie.
Mode d’extraction : Capturer l’essence des agrumes
La quintessence des agrumes dans les parfums hespéridés repose sur des techniques d’extraction méticuleuses et précises, visant à capturer l’essence la plus pure de ces fruits.
L’expression à froid : La technique traditionnelle

Principe : L’expression à froid est la méthode la plus traditionnelle et la plus couramment utilisée pour extraire les huiles essentielles des agrumes.
Il existe 2 méthodes:
- Pelatrice: Après avoir été lavés , les fruits sont jetés dans une machine qui, en grattant la peau, libère l’huile contenue dans les poches oléifères du zeste. On sépare ensuite l’eau de l’huile essentielle à l’aide d’une centrifugeuse et d’un décanteur.
Cette méthode préserve la fraîcheur et l’intégrité des notes olfactives, capturant ainsi l’essence véritable du fruit que l’on pêle sans altération due à la chaleur.
- Sfuma Torchio: cette autre méthode consiste à broyer les fruits en entier avec leur jus avant de passer à la centrifugeuse. L’huile essentielle conjugue l’aspect gourmand du fruit à la vivacité du zeste.
Distillation à la vapeur : Une alternative délicate
Bien que moins fréquente pour les agrumes, la distillation à la vapeur est parfois utilisée, notamment pour le pamplemousse et la limette. Cette technique implique de passer de la vapeur à travers les matières premières pour en extraire les composés aromatiques. La distillation à la vapeur permet d’obtenir une essence plus douce et moins acide, offrant une alternative intéressante pour des notes plus subtiles.
Innovation et avancée technologique
Extraction par CO2 Supercritique : Cette technique moderne utilise le CO2 à l’état supercritique pour extraire les huiles essentielles. Elle permet d’obtenir des extraits très purs et concentrés, en capturant des facettes olfactives parfois perdues dans les méthodes traditionnelles.
Cette avancée technologique offre de nouvelles possibilités dans la création de parfums, permettant aux parfumeurs d’explorer des facettes inédites et de créer des compositions plus complexes et nuancées.
Références iconiques de parfums hespéridés
Plusieurs créations parfumées ont marqué l’histoire des hespéridés. Citons, par exemple, « Eau d’Orange Verte » d’Hermès, une référence classique, ou « Light Blue » de Dolce & Gabbana, qui combine agrumes et notes aquatiques pour un effet moderne.
L’Eau d’Orange Verte d’Hermès, a été créée en 1979 par Jean-Claude Ellena. C’est un classique intemporel, représentatif de la fraîcheur et de l’élégance, parfait pour une sensation de propreté et de vivacité. Cette fragrance s’ouvre sur une explosion vivifiante d’orange verte, offrant une fraîcheur intense et un départ pétillant. Le cœur révèle des nuances de menthe et de cassis, apportant une dimension verte et légèrement fruitée.
Enfin, le fond est composé de patchouli et de notes boisées, donnant au parfum une profondeur et une sophistication subtiles.
Light Blue de Dolce & Gabbana a été créé en 2001 par Olivier Cresp. Light Blue est une fragrance emblématique de l’été, connue pour sa légèreté et son caractère joyeux, idéale pour les jours ensoleillés.
En tête, le parfum éclate avec des notes fraîches de pomme Granny Smith et de citron de Sicile, créant un départ énergique et rafraîchissant.
Le cœur floral se compose de jasmin et de bambou, offrant une touche de douceur et d’élégance.
Les notes de bois blancs apportent une chaleur discrète et une sensation de propre.
Bigarade Concentrée de Frédéric Malle est créé en 2002 par Jean-Claude Ellena. C’est une fragrance minimaliste et raffinée, caractérisée par sa pureté et sa clarté, capturant l’essence de l’orange amère de manière unique et contemporaine.
La bigarade domine dès l’ouverture, offrant une fraîcheur hespéridée avec une pointe d’amertume distinctive. Le cœur est épuré, mettant en avant les aspects frais et légèrement épicés de la bigarade. La base est sobre, avec une touche de rose et de bois pour équilibrer l’amertume.
Mandarine Basilic de Guerlain est créé en 2007 par Marie Salamagne. C’est une fragrance dynamique et ensoleillée, parfaite pour ceux qui recherchent un parfum frais et naturel. L’alliance de la mandarine et du basilic crée une expérience olfactive unique, à la fois hespéridée et aromatique.
Dès l’ouverture, le parfum dévoile une explosion de mandarine, apportant une fraîcheur juteuse et pétillante caractéristique. La mandarine, avec son éclat hespéridé, donne immédiatement une sensation de vitalité et d’énergie.
Le basilic, ingrédient central de ce parfum, s’entremêle avec les notes d’agrumes, apportant une touche verte, légèrement épicée et aromatique. Cette association crée un contraste rafraîchissant et vivifiant, évoquant un jardin méditerranéen en plein été.
Puis des touches de thé vert et d’ambre ajoutent une dimension subtile et une profondeur au parfum. Le thé vert apporte une légère astringence, tandis que l’ambre offre une douce chaleur, équilibrant la fraîcheur des notes de tête et de cœur.
Escale à Porto Fino de Dior, créé en 2008 par François Demachy, fait partie de la collection « Les Escales de Dior ». est un parfum qui capture l’essence de la dolce vita italienne, avec ses notes hespéridées rafraîchissantes et ses accords floraux délicats.
Le parfum s’ouvre sur des notes hespéridées éclatantes, avec une prédominance de bergamote et de citron. Cette combinaison crée un départ frais et pétillant, évoquant l’énergie vivifiante de la côte méditerranéenne.
Au cœur, la fragrance dévoile un bouquet de fleurs blanches, avec un accent particulier sur la fleur d’oranger et le petit-grain. Ces notes florales apportent une touche de douceur et d’élégance, équilibrant la fraîcheur des agrumes.
Puis arrivent l’amande amère et le musc, offrant une finition douce et légèrement crémeuse. Cette combinaison confère au parfum une sensation de confort et de chaleur, tout en maintenant sa légèreté.
California Dream de Louis Vuitton, lancé en 2020, est une création de Jacques Cavallier qui célèbre la splendeur des couchers de soleil californiens.
La note de tête est dominée par la mandarine, apportant une explosion juteuse et ensoleillée.
Juste derrière la mandarine, la poire ajoute une douceur fruitée et délicate. Cette note crée un équilibre parfait avec l’acidité de la mandarine, apportant une touche de rondeur et de suavité.
L’ambrette, avec ses nuances musquées et légèrement fruitées, offre une transition douce entre les notes fruitées de tête et le fond plus riche. Elle confère au parfum une sensation de flottement naturelle et de confort.
En fond, le benjoin se révèle avec ses facettes résineuses et légèrement vanillées. Cette note apporte une richesse et une profondeur au parfum, prolongeant la sensation de chaleur et de sérénité du coucher de soleil.
Les hespéridés ne sont pas seulement des parfums ; ils sont une expression de joie, de fraîcheur et de vitalité. De l’antiquité à nos jours, ces fragrances ont traversé les époques, se réinventant constamment tout en conservant leur essence intemporelle. Alors que nous achevons notre exploration des hespéridés, nous sommes laissés avec une question excitante : quel sera le prochain chapitre dans l’évolution de cette famille olfactive fascinante ? Avec les avancées continues en parfumerie et la créativité sans limite des parfumeurs, l’avenir des hespéridés promet d’être aussi lumineux et rafraîchissant que leur passé.

